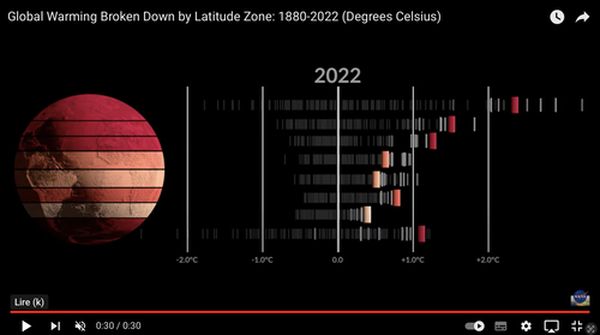Blog Club des Argonautes
Actualités scientifiques relatives au changement climatique, à l'océan et à l'énergie des mers.
Les membres du Club des Argonautes souhaitent partager certaines de leurs lectures, reflexions ou discussions. C'est l'objectif des publications de ce blog.
Le Club des Argonautes a été créé en 2003 par des chercheurs et des ingénieurs retraités qui ont contribué des programmes de recherche sur le climat, les océans, l’eau, la biosphère et l’énergie. Ils se réunissent une fois par mois pour discuter les résultats récents de la littérature scientifique, les progrès dans l’observation de la Terre, les avancées techniques et les politiques de réduction ou d’adaptation au changement climatique en cours.
....................
Propos sur le climat et ses composantes, au Club des Argonautes
Lors de sa création, le Club des Argonautes s’est concentré sur l’explication des mécanismes du climat, et aussi sur les arguments destinés à contrer les déclarations des climatosceptiques. Vingt ans plus tard, le changement climatique est devenu une réalité admise par une très forte majorité, et les invectives des climatosceptiques sont stériles. En témoigne un article paru dans «Climate» (et non pas dans «Journal of Climate!») qui attribue le changement climatique aux variations du rayonnement solaire : cet article, violemment contré par Gavin Schmidt, fera sans doute le buz chez les climatosceptiques dont la motivation principale est : «nous ne voulons pas changer de mode de vie». Le débat n’est donc pas sur la contestation de la science, et le site web des Argonautes va évoluer vers un blog présentant des articles généralement courts, sur des sujets divers liés au climat, et sur des résumés des discussions que nous avons chaque mois, autour des articles récemment parus, des décisions et prises de positions relatives au climat, et des événements climatiques remarquables.
Yves Dandonneau
------------------------------------------------
Décembre 2024
La Conférence UNOC 3 à Nice en juin 2025
Nouvellement «Argonaute», Patrick Vincent a été guidé à ses débuts par des «anciens» que nous connaissons bien, Argonautes eux mêmes, ou proches des Argonautes. On peut dire qu’il est un Argonaute de deuxième génération, le premier. Il nous a détaillé les enjeux et les préparatifs de la prochaine conférence UNOC 3 (United Nations Océan Conférence 3) qui se tiendra à Nice en juin 2025, organisée conjointement par la France et le Costa Rica. Par rapport aux deux conférences précédentes qui se sont tenues à New York en 2017 et à Lisbonne en 2022, celle ci essaiera de faire avancer les réglementations permettant d’assurer des conditions durables pour l’exploitation des océans. Cet aspect qui sera prioritaire a été très peu financé jusqu’à présent. Il est anticipé qu’il sera difficile d’obtenir des engagements collectifs ambitieux, mais il est prévu que des gouvernements puissent émettre des engagements sur les points qu’ils jugent importants. Dix thèmes seront discutés : pêche, écosystèmes, coopération, pollution, lien biodiversité – climat, soutenabilité, ressources alimentaires, connaissances et santé, lois nécessaires pour tendre vers les objectifs, et financement.
La conférence proprement dite qui s’ouvrira le 8 juin par une célébration de la journée mondiale de l’océan, sera précédée par trois évènements : un Congrès Scientifique (One Ocean Science Congress) du 4 au 6 juin, organisé par le CNRS et l’IFREMER, auquel participeront environ 2000 scientifiques, un sommet le 7 juin sur la montée des océans et la résilience, et un forum le 8 juin sur l’économie bleue et les moyens de financer des transports maritimes durables. C’est Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, qui pilotera l’action de la France, et le Ministère des Affaires Étrangères ainsi que le Secrétariat Général de la Mer y auront aussi un rôle important. La publication d’un document de recommandations scientifiques élaborées après le Congrès Scientifique est prévue pour fin mars 2026.
Santé et Océans ne sont pas en France étudiés conjointement, les océanographes ne s’étant pas encore emparés de ce sujet. Les énergies marines renouvelables ne font pas l’objet de séances spéciales, mais seront abordées chaque fois qu’il sera question de durabilité ou d’économie bleue. Parmi ce qu’on peut espérer de cette conférence, citons Mercator, qui développe des outils de simulation numérique de l’océan, et qui devrait évoluer vers une organisation intergouvernementale ; IPOS (International Panel on Ocean Sustainability) qui deviendrait non pas un équivalent du GIEC, mais aurait pour fonction de bâtir une synthèse des connaissances pour les décideurs ; « Space for Ocean », à organiser, qui apporterait des services aux pays qui n’ont pas les moyens d’être autonomes dans le domaine spatial pour l’océan ; comment pourrait on disposer des connaissances existantes pour appuyer un moratoire sur l’exploitation des grands fonds marins. Les aires marines protégées sont un sujet conflictuel, en particulier en France où les niveaux de protection de ces aires sont faibles.
L’intelligence artificielle s’installe rapidement dans la prévision climatique
A suivre les médias, il semble que l’intelligence dite « artificielle » est en voie de remodeler nos activités et, que nous en tenions les rênes ou pas, notre futur. Plusieurs fois, une meilleure prévision météo par l’IA que par les modèles des agences nationales a été mise en avant, rappelant la victoire de l’ordinateur Deep Blue contre le champion au jeu d’échecs Kasparov. Cette mise en rivalité peut laisser croire qu’il y a d’un côté les modèles de prévision déterministes basés sur la simulation numérique des processus physiques, et de l’autre, l’intelligence artificielle qui, inéluctablement finirait par dominer. Il n’en est rien : les météorologues et les climatologues ont reconnu très vite les améliorations que permet l’intelligence artificielle, et on introduit de plus en plus de modules dans la chaîne de la prévision météorologique, y compris dans des modules physiques. La tendance est d’utiliser des langages de très haut niveau afin de manipuler ces modules comme des briques. Ceci permet d’élaborer les prévisions beaucoup plus rapidement, et donc de pouvoir prendre des mesures d’alerte plus précoces. On peut voir sur le site du Centre Européen comment le recours à l’IA permet de mieux prendre en compte les données de sondeurs micro-ondes au-dessus des banquises, pour lesquelles on ne dispose pas d’équations satisfaisantes. Un autre domaine dans lequel l’IA devrait apporter des progrès est celui des nuages, dont la physique est très complexe. L’application de l’IA aux projections climatiques à long terme est beaucoup moins avancée que pour la prévision météorologique, mais certains des modules utilisés en météo sont introduits dans les modèles climatiques, notamment pour corriger les dérives.
Dixièmes Assises Nationales des Energies Marines Renouvelables
Il y a surtout été question d’éolien offshore, tandis que des solutions énergétiques moins répandues, comme la climatisation par l’eau de mer, n’ont pas été évoquées. Un point mérite cependant d’être souligné car il va à l’encontre de la règle de la libre concurrence chère à l’Union Européenne : celle ci élabore le «Net Zéro Industrial Act», par lequel elle s’efforce de soutenir la transition écologique et de renforcer sa compétitivité industrielle. Le strict respect de la libre concurrence conduit à aller au moins coûteux, et par là, bien souvent, à choisir des équipements produits hors de l’Europe à des coûts inférieurs. Cette logique de la libre concurrence prônée jusqu’à présent par l’Europe conduit donc à une perte inéluctable de souveraineté. Or, lors de ces Assises, le mot d’ordre était d’accepter d'installer des énergies marines plus coûteuses, mais dont on aurait la maîtrise. L’UE, malgré sa préférence pour la concurrence non faussée, accepterait donc enfin de faire des exceptions. les exposés des conférenciers sont accessibles sur internet.
La conférence publique du Bureau Des Longitudes de décembre consacrée au satellite SMOS
Lancé en 2009, le satellite européen SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), est toujours actif sur son orbite et fête ses 15 ans. A son tableau, de très beaux résultats, comme la cartographie globale de l’humidité des sols et de la salinité des océans, ce pourquoi il a été conçu, et aussi la détection d’émissions électromagnétiques par certains pays et activités à des fréquences interdites, une cartographie des fines glaces de mer, l’observation de vents violents sous les cyclones, le suivi du gel et du dégel des sols, l’observation de la fonte des glaces au Groenland, et l’observation de lentilles d’eau douce d’une durée de vie de plusieurs semaines en mer. Malgré ces résultats remarquables, SMOS n’a pas atteint la renommée qu’il mérite pourtant : la raison, peut être, est que sa communauté d’utilisateurs est restée trop restreinte, faute d’une communication à la hauteur de la réussite de l’expérience. A l’opposé, une équipe très large s’est constituée autour du satellite SWOT, dédié lui aussi à l’hydrologie et à l’océanographie, et qui produit depuis deux ans des résultats remarquables.
Une suite opérationnelle de SMOS (qui a tout de même duré 15 ans, et continue de fournir d’excellentes données) dans le cadre de Copernicus serait le plus logique, mais rien n’est encore prévu.
Le nouveau plan local d’urbanisme de Paris
Ce plan qui a été adopté en novembre dernier, après quatre années de consultations et de délibérations, fait la part belle à l’écologie. S’adapter au changement climatique en est la ligne directrice, avec, pour cible essentielle, réduire les conséquences de l’effet d’îlot de chaleur urbain qui aggrave les canicules. La végétalisation en sera un outil privilégié, l’évapotranspiration des végétaux constituant un puits pour l’énergie. Cette végétalisation a déjà été mise en œuvre dans d’autres pays, notamment au Chili, où un inconvénient majeur est très vite apparu : par souci d’économies des ressources en eau, il avait été décidé d’arroser avec des eaux usées les murs végétaux aménagés, et des microbes ont ainsi été répandus dans les rues et ont causé des intoxications. Voilà un écueil qu’il faudra éviter à Paris.
La communication sur le changement climatique
Il y a une vingtaine d’années, les débats organisés par les médias opposaient souvent des climatologues à des orateurs climatosceptiques, et on doit reconnaître que les premiers n’étaient pas très à l’aise dans l’art de la communication vers le grand public. C’était avant (bien avant!) que Françoise Vimeux s’affirme peu à peu dans ce rôle de communicante scientifique sur le changement climatique. Il ne s’agit plus d’expliquer l’effet de serre face à ceux qui le niaient et qui ont perdu cette bataille, mais d’expliquer comment le changement climatique agit à chaque fois, de plus en plus souvent, que des évènements climatiques exceptionnels ont lieu. Et Françoise Vimeux fait cela très bien, avec beaucoup de clarté et de précision.
Les rivières atmosphériques parviennent à des latitudes de plus en plus élevées
Les rivières atmosphériques sont des longues bandes d’air chargé d’humidité en déplacement, en général vers le Nord-Est dans l’hémisphère nord (vers le sud est dans l’hémisphère sud), et qui amènent des pluies intenses vers des latitudes plus élevées.
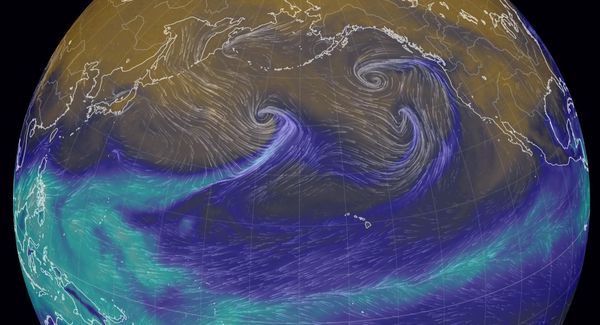
Contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère dans le Pacifique nord le 20 décembre 2024,
vu par earth.nullschool.net/.
En bleu, trois rivières atmosphériques, avec plus de 40 kg d’eau par mètre carré : en marron, moins de 20 kg/m².
Une étude récente montre qu’au cours des 40 dernières années, ces rivières atmosphériques se sont en moyenne décalées vers les pôles de 6 à 10 degrés de latitude (distance de Barcelone à Orléans, ou à Dunkerque), et cette migration considérable a des conséquences sur la répartition des pluies extrêmes et des zones de sécheresse. La principale raison de cette migration est le réchauffement de la surface des océans.
Un usage inattendu de nos téléphones portables
Les téléphones portables sont très nombreux, et il y en a un peu partout, du moins sur les terres émergées. Une étude conduite par Google utilisant 40 millions de téléphones portables a montré que ceux ci permettaient de réduire l’erreur de localisation du système GPS de 10 à 20 %, et la diminuer davantage encore dans les régions les moins bien observées. Le principe utilisé est le suivant : plus l’atmosphère est ionisée, plus le signal radio émis pour le GPS est ralenti, et cela affecte les mesures. On y remédie grâce à des cartes en temps réel de la densité des électrons liée à cette ionisation. Ces cartes sont cependant affectées par les fluctuations de l’ionisation, dues par exemple à des tempêtes solaires, et l’observation très fine, à la nanoseconde près, des communications par téléphone portable permet d’affiner ces cartes dans les régions où les données manquent, comme l’Afrique, l’Amérique du sud ou l’Asie du sud. Ce n’est pas la première fois que les téléphones portables en grand nombre se montrent utiles : ils ont aussi permis de cartographier des déplacements de l’écorce terrestre.
Regain d’intérêt pour les bouées habitées pour observer l’océan
Certains se souviennent de la «bouée Cousteau» qui a accueilli à la fin des années 60 des scientifiques pour l’observation de l’océan à un point fixe. Après avoir subi un incendie en 1965, elle a été mise hors service fin février 1970 à la suite de fissures dans le « tube » (les 50 m sous l’eau), provoquées par une vague scélérate lors d’une tempête de fin novembre 1969. Dans le Pacifique nord, des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography ont utilisé le FLIP, une version de bouée améliorée : allégée, cette bouée se couche à l’horizontale sur la mer comme un navire, et une hélice la propulse jusqu’au point où elle doit être mise en opération. Par un jeu de lests, on la fait se mettre en position verticale, et l’avant devient alors un laboratoire au dessus de la surface de la mer, porté et stabilisé par les 100 mètres de la partie arrière immergée du navire. Le FLIP a été utilisé jusqu’en 2013, et devait être démantelé en 2023, mais la société anglaise DEEP, spécialisée dans l’habitat marin pour la recherche et l’exploration, l’a acheté in extremis pour le remettre en état au service de programmes d’océanographie. Et en France, sous l’impulsion de Jean Louis Etienne, on prépare le Polar Pod, sur le même principe que le FLIP.
-----------------------------------
Novembre 2024
Que faisions nous entre 1960 et 1990 ?
Inversion des rôles ce 8 novembre : alors que nous écoutons habituellement un scientifique, nous parler d’un élément du système climatique, cette fois, l’objet n’est autre que nous, ou du moins la communauté scientifique dont nous faisions partie et dans laquelle il y a plus de trente ou quarante ans nous avons mené nos activités de recherche. Notre invité, Ianis Cammilleri, est un étudiant, diplômé de l’école des Ponts et Chaussées (2002) et son intérêt pour les problèmes d’énergie et de climat l’a amené à suivre en 2023-2024 un master 2 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Son thème de recherche était "les scientifiques français face à l'alerte climatique (1960 – 1992)", et ce n’est qu’en approchant de la fin de son mémoire qu’il a appris qu’un club de retraités, les Argonautes, était composé d’anciens chercheurs qui avaient participé à l’amélioration des connaissance sur le climat et le changement climatique à cette période. Ianis a nourri son travail par la lecture d’un très grand nombre, très impressionnant, de rapports de groupes de travail et de conférences nationales et internationales, au fil desquels s’est construite l’alerte climatique, et se sont manifestés des freins qui ont ralenti sa prise en compte comme une priorité. Annoncé par Arrhenius en 1896, et solidement établi par les travaux de modélisation de Manabe dans les années 1960, le changement climatique dû à l’accumulation des rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère n’a été pleinement admis qu’après 1990, lorsque les archives climatiques piégées dans les glaces ont montré que la concentration en gaz carbonique de l’atmosphère était plus élevée pendant les périodes interglaciaires. Les débuts de la période qu’a étudiée Ianis correspondent d’une part à la naissance d’un mouvement écologiste très puissant aux Etats Unis, et au développement de la modélisation numérique de la dynamique de l’atmosphère, mais l’idée que le climat puisse changer à cause du dioxyde de carbone s’est ensuite heurtée à des doutes. En France ces doutes ont longtemps freiné l’acceptation du risque climatique. Ils étaient dus au peu de considération, jusqu’au sein de l’Académie des Sciences, que les physiciens avaient pour la jeune science du climat, qui s’édifiait autour de modèles numériques qui simulaient des processus physiques qui relevaient de « sciences exactes » mais qui devaient aussi prendre en compte les incertitudes dans des domaines moins bien connus.
Cette période pendant laquelle l’alerte climatique a été retardée en France n’a toutefois pas été une période stérile, elle a vu au contraire éclore une recherche très active, et qui a au final profité à la climatologie : les travaux consacrés à la chimie atmosphérique. Ceux ci ont commencé après les démêles avec les États Unis à propos du supersonique Concorde qui ont eu pour effet de stimuler les recherches sur la haute atmosphère et sa chimie, et le « trou d’ozone », notamment la chimie hétérogène (interaction entre gaz et cristaux formés à basse température de manière saisonnière dans le vortex polaire sud et dans une moindre mesure au nord) ; C'est sur cette base que dès la découverte du trou d'ozone, les chimistes ont pu identifier théoriquement et expérimentalement le rôle des chlorofluorocarbones. Ces progrès ont donné lieu au prix Nobel de chimie 1995 attribué à Crutzen, Molina et Rowland. A l’instar des climatosceptiques qu’on a connus plus tard, il y a eu alors des « ozonosceptiques », et parmi eux, des écologistes qui estimaient que les scientifiques derrière ces travaux étaient manipulés par le lobby du nucléaire. Dans ce domaine, Gérard Mégie a obtenu des succès remarquables, d'abord pour avoir développé et exploité un lidar ozone, ensuite pour avoir été ( avec le Service d'Aéronomie) à l'origine de campagnes de mesures par ballons atmosphériques à Kiruna, pour avoir créé une station lidar à Concordia et embarqué des lidars sur des avions et des satellites, et également avoir présidé la Commission Internationale sur l'Ozone qui a été déterminante pour la signature du Protocole de Montréal à la suite duquel l’usage des chlorofluorocarbones a été fortement réduit. Il a ensuite déployé son énergie pour bâtir l’Institut Pierre Simon Laplace, une fédération de laboratoires dédiés à l’étude du climat.
Associés à ces recherches, les Argonautes ont accompagné les leaders scientifiques de cette époque, et ont souvent été impliqués dans les évènements de la chronologie exposée par Ianis Cammilleri, qui a été l’occasion d’une très agréable immersion dans nos débuts.
Le Lac d’Ourmia en Iran subira-t-il le même sort que celui de la Mer d’Aral ?
Le Lac d’Ourmia est une étendue d’eau de plus de 5000 km² située au nord-ouest de l’Iran. Il est alimenté en eau et en sels minéraux par des rivières et des nappes phréatiques, et est endoréique, ne se vidant que par l’évaporation et par les prélèvements pour les besoins en eau des habitants de la région. Il se concentre donc et est salé, comme le sont la Mer d’Aral et la Mer Morte. Il a fait l’objet d’une conférence par François Molle à Montpellier au mois d’octobre. La Mer d'Aral a vu son niveau et son volume drastiquement baisser à cause du choix fait à partir de 1960 par l'Union Soviétique de faire des républiques d'Asie Centrale un lieu prioritaire pour la culture irriguée du coton. Cela n’a pas été le cas pour le lac d’Ourmia, pour lequel au contraire des mesures préventives ont été prises par l’Iran qui a appliqué un «Programme de restauration du lac d’Ourmia». Malgré cette réelle volonté de l’Iran qui y a consacré des budgets conséquents et malgré un environnement scientifique de qualité, dans un pays pourtant réputé autoritaire, le lac subit inexorablement le même processus d’assèchement que la mer d’Aral. En cause, des prélèvements excessifs dans les rivières et dans les nappes qui l'alimentent. Ceux ci ne sont pas seulement dus à l’irrigation des cultures, mais aussi aux besoins d'une population urbaine proche, en particulier à Tabriz, pour laquelle la nappe phréatique du lac est une source d'eau domestique amplifiée par l'impact du tourisme. L'identification de l'ensemble des facteurs, qui se combinent non seulement pour empêcher l'adoption de mesures correctives appropriées, mais aussi pour accroître la surexploitation de l'eau, est essentielle pour comprendre les mécanismes de surexploitation de l'eau qui tendent à se généraliser dans le monde.
L’oxygène dans l’océan et le changement climatique
L’oxygène pénètre dans l’océan par dissolution à l’interface océan atmosphère, et sa solubilité décroît lorsque la température augmente. On devrait donc constater une perte d’oxygène de l’océan vers l’atmosphère en réponse au réchauffement climatique. Or, les mesures de concentration en oxygène réalisées en routine, notamment par le réseau BGC Argo ne montrent pas nettement un tel appauvrissement. La raison en serait un changement, lié lui aussi au réchauffement en cours, des mouvements convectifs de l’eau océanique qui enfouissent en profondeur les eaux qui se sont enrichies en oxygène au contact de l’atmosphère. En particulier, des eaux plus salées en surface dans l’Atlantique tropical, et donc plus denses, plongeraient plus profondément et en plus grande quantité, entraînant avec elles davantage d’oxygène. Cette augmentation compenserait la perte d’oxygène due à la diminution de la solubilité.
Les points de bascule sont devenus une préoccupation abondamment reprise par les médias
La menace constituée par les points de bascule du climat a fait l’objet de plusieurs conférences. Ces points de bascule sont devenus une préoccupation reprise par les médias et par les écologistes mais ce qu’on en dit manque souvent de précision et de rigueur. Le terme « bascule » lui même serait à préciser. Du point de vue des mathématiques, il en existe des catégories précises. En ce qui concerne le climat, ils évoquent des stades de l’évolution au-delà desquels celui-ci présenterait, pour de très longues durées, d’autres régimes de température, de pluie, de vent, que par le passé, globalement ou régionalement. Une variation de l’amplitude d’oscillations climatiques peut en être un signe précurseur, comme lors du passage d’un interglaciaire à une période glaciaire. Mais un point de bascule n’est pas nécessairement lié à un changement d’oscillations : par exemple, en Amazonie, on déforeste, en conséquence, les pluies diminuent, les conditions deviennent propices aux incendies, et cet enchaînement conduit à un paysage et un climat nouveaux dans la région. l’arrêt éventuel de l’AMOC est l’exemple très souvent cité de point de bascule du climat, et récemment une pétition de climatologues des pays du nord met en garde les gouvernements contre un refroidissement brutal qui pourrait frapper leur région. Pour documenter cette menace, ils utilisent toutefois un modèle dans lequel le transfert de chaleur des tropiques vers les pôles ne s’effectue que par l’océan, alors que ce transfert s’effectue tout autant par l’atmosphère.
Frontières mouvantes
Plusieurs segments de la frontière entre l’Italie et la Suisse sont déterminés par les lignes de crête des glaciers. Or, ces glaciers fondent, et donc leur ligne de crête se déplace. Pour cette raison, la Suisse et l’Italie ont nommé une commission mixte pour tracer une nouvelle frontière qui tienne compte de ces changements, qui viennent d’être actés. Ce cas n’est pas unique. Le même genre de litige a eu lieu entre le Chili et l’Argentine, dont la frontière reposait sur des poteaux plantés sur le glacier Hielo Sur, et ces poteaux se déplaçaient avec la glace. Il a été décidé entre les deux pays de définir la frontière selon des critères de coordonnées géographiques, et comme en 1494 au traité de Tordesillas, le nouveau tracé a été adopté sous l’arbitrage… du Pape !
L’élection de Donald Trump et les scientifiques du climat aux Etats Unis
Il est encore trop tôt pour voir quelles conséquences aura cette élection sur nos collègues des Etats Unis d’Amérique. Mais on peut se rappeler ce qui s’était passé lors de la première élection de Donald Trump en 2017 : il s’était immédiatement retiré des accords de Paris, les crédits pour les recherches sur le climat avaient été drastiquement réduits, et il y avait eu un très fort attrait de l’Europe, et de la France en particulier, pour les chercheurs américains. Un système de bourses avait même été instauré en France pour encourager leur venue.
................................................
Octobre 2024
Cette vidéoconférence a été l’occasion pour les Argonautes de se rendre dans le Gers et d’y recevoir Mr Bezerra, maire de Montréal du Gers, Mr Boison, président de la communauté de communes de la Ténarèze dont le siège est à Condom, et Madame Poggi, directrice générale adjointe de cette communauté de communes. Bernard Pouyaud nous a aussi parlé des structures de concertation en matière d’environnement sur le Plateau de Millevaches. La réunion a donc été en grande partie consacrée au monde rural, au centre d’enjeux climatiques et environnementaux pour lesquels les choix à adopter reposent sur un ensemble de structures complexes, à l’image de la variété des intérêts à gérer, complexité dont nous avons tenté de rendre compte ci-dessous.
Les autres sujets de nos discussions ont été l’association Infoclimat, les racines et la biologie des sols, les séismes et la propagation d’ondes, la dissymétrie chaud/froid des extrêmes de températures, et le déséquilibre énergétique de la Terre de 2000 à 2024.
Montréal du Gers et la communauté de communes de la Ténarèze
La commune de Montréal couvre 6300 ha, essentiellement agricoles avec une dominante viticole ; aujourd’hui, ce sont principalement des grandes propriétés (plus de 100 ha, jusqu’à 500 et plus), beaucoup de petits exploitants ayant disparu. La bascule s’est faite avec l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord dans les années 60 qui apportaient de nouvelles techniques. Cela s’est accompagné de la disparition des forêts (chênes) et surtout d’une diminution par deux de la population depuis la libération.
Sur le réseau hydrographique de l’Auzoue (affluent de la Baïse, puis de la Garonne), les moulins existent toujours mais ne sont plus exploités ; les endiguements ne sont pas entretenus, cependant les débordements sont contrôlés en particulier par la présence d’un canal de dérivation sur la commune de Fourcès à l’aval qui a permis de limiter l’inondation dans la vallée (Montréal, et en amont). Il reste bien-sûr les évènements extrêmes qui ont des conséquences notables sur la voirie et sur l’érosion des terres agricoles. À ce propos, il n’y a que peu d’agriculteurs qui ont des pratiques anti érosives. On laboure jusque dans les fossés, la plupart des haies ont disparu, les machines sont de plus en plus lourdes (des « boeings ! »).
Mais des discussions ont lieu et des mesures se mettent en place surtout à l’initiative des collectivités. Récemment la prise de conscience à porté sur les espaces boisés en bordure de plans d’eau. De plus la ressource en eau de surface dépend de la redistribution effectuée par le canal de la Neste sur le plateau de Lannemezan (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, renommée récemment Rives & Eau du Sud-Ouest). L’approvisionnement en eau du département du Gers ne dépend donc que des Pyrénées. Il faut quand même noter que l’extension de l’agglomération de Toulouse et la centrale nucléaire de Golfech (sur la Garonne à Valence d’Agen) captent une grande partie de cette eau. Il s’y ajoute un nombre important de retenues collinaires. C’est le département qui l’a encouragé dans les années 90 et cela a été facilité par le remembrement. Autrefois, il y avait des mares dans toutes les fermes qui étaient entretenues par les propriétaires. Il n’en est pas de même avec les retenues pour lesquelles les règles administratives sont très contraignantes et rendent les curages insurmontables. Cela conduit à un très important envasement ; certaines ne stockent plus que 25 % de leur volume. « La réglementation empêche l’entretien des retenues ». Bernard Pouyaud fait remarquer que le personnel technique des collectivités s’appuie sur des textes réglementaires nationaux souvent non appropriés pour les conditions locales. C’est un message que les élus ont du mal à faire passer auprès des techniciens. D’autant plus qu’il s’y greffe souvent des blocages au nom de la biodiversité. Lors des curages se pose aussi la question des vases pour lesquelles un site d’accueil doit être défini.
La communauté de communes de la Ténarèze compte 26 communes, soit pas tout à fait 15 000 habitants, dont Condom qui a 6 500 habitants et deux communes de plus de 1 000 habitants (Montréal et Valence sur Baïse). Ces trois agglomérations portent une activité économique au-delà de l’agriculture. Une autre compétence est la voirie, ce qui est lourd dans un milieu très rural. Il s’y ajoute les chemins de randonnée, dont le chemin de St Jacques de Compostelle (branche du Puy en Velay), en lien avec les offices de tourisme et les associations de grande randonnée. La communauté de communes s’occupe aussi de l’environnement et de l’aménagement de l’espace. Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été le premier mis en place dans le département du Gers (2005). Il est en lien avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui dans le Gers couvre la quasi totalité du département et avec le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires). S’y sont rajoutées plus récemment les contraintes ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui limitent la surface constructible à 75 ha pour la CC d’ici 2034, incluant le logement et les industries, et remet en question les prévisions des communes (600 ha étaient envisagés) et va conduire à une modification du PLUI. Une piste est la réhabilitation des logements vacants, ce qui ne correspond pas vraiment à la demande des nouveaux habitants qui veulent plus d’espace, y compris des jardins. Il s’y ajoute un nombre important de résidences secondaires lié à l’exode rural et au vieillissement de la population avec un reclassement des anciens bâtiments de ferme. Parmi les jeunes, les candidats à la reprise des domaines agricoles sont peu nombreux. Cependant, le monde agricole réagit très rapidement face à toutes les contraintes administratives et environnementales. Aujourd’hui les jeunes exploitants sont tous diplômés ; beaucoup sont allés voir ce qui se passait ailleurs et ramènent des idées, pas seulement françaises. C’est un monde en transition rapide. Ces nouvelles idées commencent à percoler dans les structures territoriales. Par exemple sur les aspects énergétiques : le photovoltaïque est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs.
Bernard Pouyaud pose la question d’une homogénéité sur ces questions à l’échelle du département en donnant l’exemple de la Corrèze très contrastée entre le nord et le sud qui fait peser le poids du syndicat d’agriculteurs FNSEA sur tout le département alors que dans le nord, les résidents souhaiteraient une autre politique.
Le Gers reste un département essentiellement agricole, même si les productions principales varient selon les territoires. Il y a aussi de belles entreprises dans le Gers qui savent s’adapter : les sous-traitants d’Airbus, mais aussi la fabrication des chaises et de la girouette de ND de Paris ou, sur le territoire de la CC, une entreprise spécialisée dans la construction de châteaux d’eau et de stations d’épuration qui opère dans tout le sud de la France !
La question du climat futur est-elle prise en compte ? Jean Pailleux explique l’existence d’outils développés par Météo-France à destination des communes (DRIAS, Climadiag). Beaucoup de projets existent à l’initiative de l’Europe en particulier pour le développement d’outils donnant des informations sur les événements extrêmes. On évoque aussi le réseau Infoclimat.
Le Parc Naturel Régional du Plateau de Millevaches et les questions environnementales
Le Parc Naturel Régional du Plateau de Millevaches est l’un de ceux créés depuis 1967 dans le but d’asseoir le développement économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. Leur politique est mise en œuvre par les élus locaux, et les conseils départementaux et régionaux apportent leurs principaux soutiens financiers. Il est doté d’un Conseil scientifique (20 membres) qui a un droit d’auto saisie et doit aussi répondre aux questions que lui pose le président du Parc. La question lui a été posée de faire le point sur les connaissances scientifiques alors que les têtes des bassins hydrologiques sont de plus en plus affectées par le changement climatique.
Les membres du Conseil Scientifique ont des compétences diverses selon les formations qu’ils ont suivies et les carrières qu’ils ont menées. Le personnel technique du Parc est constitué de gens qui sont au maximum au niveau master et sont étroitement formatés par la formation générale qu’ils ont reçue, peu adaptée aux conditions locales.
Le Plateau de Millevaches est une formation granitique du même âge que le Massif Armoricain. Il s’étend sur trois départements : La Corrèze, la Creuse et la Haute Vienne, tous en Nouvelle Aquitaine, et héberge les têtes de bassin de la Creuse, de la Vienne, de la Vézère, de la Corrèze et des affluents de la Dordogne. Sa pénéplaine s’étend entre 600 et 980 m d’altitude, et n’a pas été couverte de glace par les trois dernières glaciations. Sa climatologie passée est assez bien connue grâce aux pollens conservés dans les tourbières, qui révèlent aussi les successions des modes d’agricultures au cours de l’histoire récente.
À partir de 1950, une décision politique a été de reboiser le pays, et ceci s’est fait principalement avec des résineux (Douglas) qui sont très gourmands en eau toute l’année, et aggravent la tendance actuelle à la sécheresse. Les débits des petits bassins ont nettement décru depuis 1952, et se sont même asséchés complètement en 2019 et 2022 (sans toutefois aller jusqu'à assécher le fond des tourbières). Revenir en arrière se heurte à de fortes réticences parce que la foresterie est devenue l’activité principale du pays. On a coutume de représenter le Plateau de Millevaches comme le château d’eau de la France, mais ce château granitique a une capacité faible, et il arrive maintenant qu’il se vide totalement.
Le Parc n’a aucun pouvoir de police. Il ne peut qu’émettre des avis pour ce qui concerne l’eau, les implantations d’éoliennes, de panneaux solaires etc. Exemple : le Parc a longuement discuté des inconvénients et bénéfices de l’implantation d’éoliennes pendant deux ans, avec plus d’un million d’euros d’enquêtes et d’études, pour finalement mettre un terme aux discussions, l’armée ayant déclaré que ce champ se trouvait dans la mire de ses radars. L’armée avait préalablement donné son accord pour de éoliennes d’une hauteur inférieure à 120 m, mais la rentabilité du champ nécessitait une hauteur d’au moins 150 m.
Le Parc a rédigé et distribué une charte forestière qui promeut les bons usages. Mais les forestiers ont leurs habitudes et ne la respectent pas. Par exemple, pour conserver les sols (et le carbone), il serait bon après l’abattage de laisser les souches en place. Mais ceci gène les engins utilisés pour la replantation, donc pratiquement tous procèdent à un dessouchage. Pour la commodité de conduite des tracteurs dans les pentes, on replante en suivant la ligne de plus grande pente, au lieu de suivre des courbes de niveau, ce qui accroît l’érosion du sol.
La gestion de l’eau sur le Plateau de Millevaches est encadrée par plusieurs documents :
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. C’est un document contractuel de la loi française sur l'eau régulièrement renouvelé à l'échelle des "grands bassins hydrographiques". Pour le PNR Millevaches, il y en a deux : Adour-Garonne et Loire-Bretagne.
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, pour chaque bassin (Pour le Plateau de Millevaches, bassin de la Vienne, de la Corrèze, et de la Creuse). Il faut environ 10 ans pour monter un SAGE. C’est un document juridique qui s’impose, et qui doit être consulté chaque fois qu’un aménagement ou une décision sont à prendre. Le Parc Naturel du Plateau de Millevaches est lui aussi consulté pour ces prises de décision.
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) comprend la procédure GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui est confiée aux communautés de communes.
Les départements ont aussi leurs préoccupations : ils négocient un plan départemental de la gestion de l’eau, en cours d’élaboration, dont le domaine ne correspond pas strictement à un bassin versant, se situant selon les cas en amont ou en aval. D’une façon générale, les réserves d’eau se situent en amont, et les enjeux les plus lourds se situent en aval où sont implantées la plupart des activités.
Il y a aussi des ZAN (Zones à Zéro Artificialisation Nette) et des Zones d’Accélération des Énergies Renouvelables qui concernent en partie des zones d’activité agricole. C’est le préfet qui arbitre cette complexité.
Les zones humides sont à protéger. Si on doit y toucher, il faut le faire au minimum, et si on doit malgré tout y intervenir lourdement, il faut compenser les dégâts, c’est à dire créer là où c’est possible un environnement analogue à celui qui a été détruit.
Le Parc Naturel du Plateau de Millevaches a tenté de figurer au classement Ramsar (du nom d’une réserve en Inde), en invitant à en discuter les associations, administrations, tous ceux intéressés par cet environnement. Mais devant la complexité des critères et les atteintes que cela portait aux droits de beaucoup, il a abandonné ce projet.
Le problème des captages d’eau potable : le Parc comprend 124 communes, et l’eau y est en général gérée par des régies communales (à Pérols sur Vézère, 183 habitants, il y a 11 captages, 10 châteaux d’eau, 40 km de tuyaux, et l’eau y a un pH très acide de 4,5).
Le terrain est granitique, ce qui génère des argiles et du sable. L’altération des feldspaths y produit de l’aluminium, et celui ci apparaît en abondance (jusqu’à 9 fois la dose tolérée) quand le niveau des nappes baisse. Il y a peu de contamination chimique, sauf, à signaler, à cause d’une pratique maintenant interdite qui consistait à enrober les racines des jeunes arbres lors des replantations de forêts d’une substance antifungique, qu’on retrouvait ensuite dans l’eau distribuée.
Il y a dans le Parc des petits étangs qui ont été aménagés, et sont très prisés par leurs propriétaires. Leur surface s’échauffe jusqu’à 4°C au dessus de celle des rivières, et sauf aménagement spécial cette eau chaude se déverse vers l’aval. Ces étangs sont aussi la source d’une évaporation accrue. Faire comprendre cela aux propriétaires n’est pas aisé.
Les tourbières étaient avant le réchauffement climatique alimentées surtout par ruissellement. Avec les épisodes de sécheresse qui se manifestent maintenant, elles tendent de plus en plus à n’être alimentées que par la pluie qui tombe sur leur surface, car les sols environnants, une fois secs, absorbent l’eau de pluie et ne ruissellent plus. Résultat : les tourbières régressent, s’assèchent par endroits, et on y voit des pins pousser spontanément.
La notion de continuité écologique est un thème cher aux jeunes employés des services de l’environnement. Bien souvent, ils voudraient restaurer une continuité qui n’a jamais existé. Il y a en Corrèze 600 moulins… qu’ils voudraient supprimer au nom du retour à la nature. Or, dés le moyen âge, il a été aménagé des réseaux de circulation d’eau pour des usages divers, et supprimer cela, qui est intégré dans le paysage depuis si longtemps, est assez vain et contre productif.
La Corrèze a été l’une des premières zones de France à être électrifiée, dès 1920, avec les barrages (Bort-les-Orgues, Vassivières…) qui ont aussi pour rôle de maintenir un stock d’eau indispensable pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux sur la Vienne. Rives & Eau, une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la sécurisation des ouvrages hydrauliques, est en charge d’un projet récent en Corrèze/Charente/Charente Maritime qui consisterait à réalimenter le bassin de la Charente à partir du haut-bassin de la Dordogne.
La filière bois-énergie, doublement subventionnée (lors de l’abattage et lors de la replantation) s’avère assez catastrophique, les dégâts faits au sol, les transports du bois, annihilant l’avantage en termes de bilan carbone.
Une mine d’informations sur le climat en France : infoclimat
Infoclimat est une association qui rassemble et met à disposition du public des informations météo, en particulier mais pas seulement, celles des 600 stations météorologiques de ses adhérents en France métropolitaine, qui forment un réseau dense et complémentaire de celui de Météo France. Un aspect positif à souligner est que les stations de Infoclimat sont pour la plupart situées à la campagne tandis que celles de Météo France sont souvent en zone urbaine : il y a donc complémentarité entre les deux réseaux plutôt que redondance. Ces 600 stations installées et entretenues par des amateurs font l’objet de contrôles de qualité rigoureux assurant la fiabilité des mesures. De plus, infoclimat a réalisé un site web qui permet un accès très facile aux données de chacune des stations, ainsi qu’à des synthèses variées sur la température, la pluviométrie, l’ensoleillement, ou la pression atmosphérique. Le site permet aussi d’accéder à des données satellite, ainsi qu’à des synthèses climatiques. Ce site remarquable, en particulier grâce aux animations graphiques qu’il propose, a été construit en grande partie par un informaticien très talentueux qui vient de cesser son activité et a été remplacée par un salarié. Le Club des Argonautes envisage de devenir membre de Infoclimat, et d’en devenir « sponsor » en faisant un don.
Les sols vivants, en interaction avec le climat
Avec des épisodes de sécheresse et de canicule de plus en plus intenses et fréquents, les plantes sont souvent touchées par un stress hydrique. Dans les sols, ce sont les racines des plantes qui ont pour tâche d’en extraire l’eau. Ceci est d’autant plus difficile que les sols sont secs, et certaines plantes réussissent mieux que d’autres : c’est un domaine où, par sélection des espèces végétales, ou par modification génétique, on peut obtenir des variétés plus résistantes à la sécheresse. La capacité des racines à fournir de l’eau aux plantes en période de sécheresse, ou à résister au contraire aux inondations, est un sujet de recherche qui a été mis en avant récemment lors d’une séance spéciale de l' Academie d'Agriculture, et lors d’une vidéoconférence de l’IRD sur la santé des sols. Cette dernière repose sur une microfaune et une microflore souterraines indispensables pour restaurer le contenu en carbone organique des sols qui s’est effondré à cause des pratiques agricoles de ces dernières décennies.
Un clin d’oeil : et si on disposait de quelques secondes pour détecter les séismes ?
Lorsqu’une rupture intervient sous l’écorce terrestre, le choc engendré se propage à l’intérieur de la Terre sous la forme et avec la vitesse d’une onde sismique, c’est à dire quelques kilomètres par seconde. Il en résulte aussi une modification de la disposition locale des masses, et nécessairement, une modification du champ de gravité, qui devrait donner naissance à une onde gravitationnelle. Or, cette dernière devrait se propager à la vitesse de la lumière, bien plus vite que l’onde sismique. Si on était capables de détecter cette onde gravitationnelle, et de réagir immédiatement, on aurait quelques secondes d’avance sur l’arrivée du séisme destructeur. C’est peu, mais cela peut suffire pour s’enfuir très vite de sa maison !
Extrêmes de température : qui croît le plus vite, le chaud ou le froid ?
Il semble se confirmer année après année que les températures maximales quotidiennes croissent plus vite que les températures minimales quotidiennes, pour un mois ou une année donnés. Ceci a été vérifié en France, où les stations de Météo-France ont recensé 55 records de froid mensuels contre 2 451 records de chaud sur toute l’année 2023. Janvier 2024, malgré un « épisode hivernal » en début de mois, a connu seulement neuf records de froid contre 170 records de chaud. Attention toutefois à un biais lorsque le domaine d’observation englobe des températures négatives : à 0°C, le gel de l’eau dégage de la chaleur et offre donc une résistance au refroidissement, qui complique l’interprétation des résultats.
Le déséquilibre énergétique de la Terre s’accroît
Le système climatique de la Terre reçoit de l’énergie du Soleil, principalement sous forme de rayonnement visible, et rayonne lui même vers l’espace sous forme de rayonnement infra rouge, et aussi de rayonnement dans le domaine du visible pour la partie réfléchie du rayonnement solaire. La différence, positive, entre les rayonnements entrant et sortant a pour résultat le réchauffement climatique en cours, et est désignée par les termes « déséquilibre énergétique de la Terre ». C’est une quantité difficile à évaluer, en partie en raison de sa très forte variabilité dans le temps, due pour une large part à la variabilité à toutes les échelles de temps de la couverture nuageuse qui réfléchit le rayonnement solaire incident vers l’espace. La figure ci dessous montre sur un même graphique l’évolution depuis 2000 du rayonnement solaire absorbé (c’est à dire le rayonnement solaire incident moins le rayonnement solaire réfléchi vers l’espace), en noir, et du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers l’espace, en rouge.
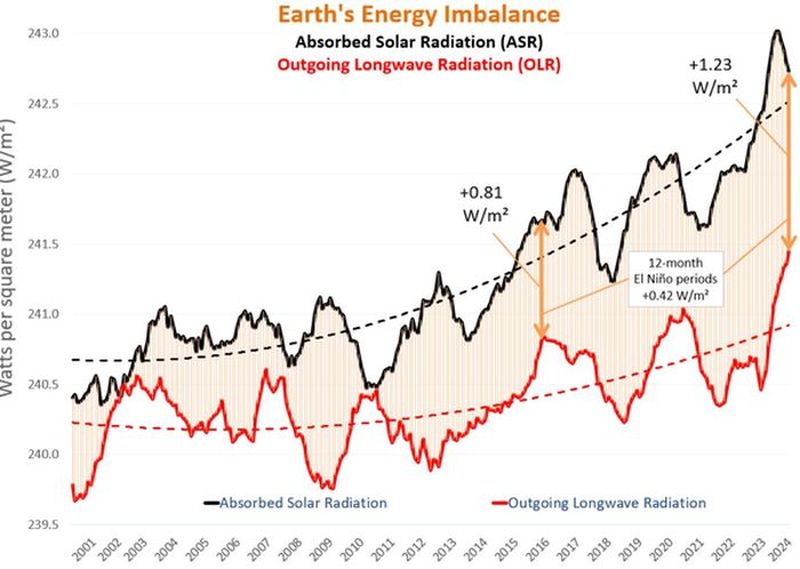
Le déséquilibre énergétique de la Terre est la différence entre ces deux termes. On voit qu’il est très variable, à des échelles de temps supérieures à l’année, mais une augmentation depuis 2000 se dégage nettement. Elle est illustrée ici par la différence entre deux périodes dont la similarité rend possible une comparaison : les épisodes El Niño de 2016 et de 2023, entre lesquels ce déséquilibre est passé en sept ans de 0,81 W/m² à 1,23 W/m².
Un conseil de lecture
« Les métamorphoses de la Terre » par Peter Frankopan.
Du Big Bang à nos jours, notre Terre n’a cessé de se transformer sous les effets des mouvements tectoniques, des variations climatiques, de l’activité du Soleil ou encore des éruptions volcaniques. Comment ces changements ont-ils affecté l’histoire humaine ? Comment notre espèce s’est-elle adaptée à un environnement profondément modifié par les glaciations ou les périodes de réchauffement ? Pour répondre à ces interrogations, Peter Frankopan s’est engagé dans une entreprise majeure et inédite : croiser notre histoire, nos innovations, nos empires, nos périodes de stabilité ou de bouleversements avec l’histoire du climat telle que les découvertes scientifiques les plus récentes peuvent l’établir. À l’heure où, face au défi climatique, notre futur semble plus incertain que jamais, Peter Frankopan nous convie à mieux apprendre de notre passé et transforme profondément notre manière de penser l’histoire du monde.
...............................
Septembre 2024
Michel Lefebvre
Michel Lefebvre a été un acteur et un animateur inlassable du développement de l’observation spatiale pour l’océanographie. C’est en grande partie grâce à lui que les chercheurs français ont pu très tôt, avec le satellite TOPEX-POSEIDON accéder à des données de topographie précise et globale de l’océan pour étudier les courants marins. Il était doué de qualités humaines exceptionnelles et a entraîné avec lui toute une génération de chercheurs. Le rond point situé à l’entrée du Centre National d’Études Spatiales à Toulouse portera son nom, ainsi qu’en a décidé la municipalité de Toulouse. Michel Lefebvre, qui nous a quittés en 2019, est l’un de ceux qui ont fondé le Club des Argonautes, et nous nous réjouissons de l’hommage qui lui est ainsi rendu.
Episodes de canicules, de sècheresses....
Les épisodes de canicules, de sécheresses, les crues, interrogent : cela s’est-il déjà produit dans le passé, cela va-t-il empirer ? Les données pour répondre à ces questions sont de plus en plus facilement accessibles. L’accès aux données hydrométriques, accessibles partiellement depuis 2000 par hydro Portail, a évolué depuis juin 2024 en donnant accès à tout l’ensemble des données hydrométriques, par le portail data-eaufrance. Météo-France a ouvert ses archives au public en 2023 (voir page actualité septembre 2024 à ce sujet). Notons aussi que les données des stations météorologiques des particuliers (au nombre de 800 environ pour la France métropolitaine), dont la qualité est vérifiée avec rigueur, sont accessibles depuis le site de Infoclimat (https://www.infoclimat.fr/).
SWOT et EarthCARE
Les premières données rapportées par de nouveaux satellites tiennent leurs promesses, haut la main. SWOT (Surface Water Ocean Topography), qui mesure le niveau de l’eau avec une précision et une définition inaccessibles jusqu’à présent, par interférométrie radar, apporte des informations sur les ressources terrestres en eau, sur les variations de contenu des lacs, et sur les courants et tourbillons marins à petite échelle. EarthCARE muni entre autres instruments d’un radar profileur de nuages permet d’observer et de suivre à haute définition la structure des nuages et la répartition des tailles des gouttelettes d’eau et des cristaux de glace.
Accord de Paris
+ 1,5°C, + 2°C en 2050 ? 2°C, c’était la première proposition faite lors de la préparation des Accords de Paris. C’était aussi la prévision d’Arrhénius dans l’hypothèse d’un doublement de la concentration en CO2 dans l’atmosphère (soit 2 x 280 = 560 parties par million). C’est à la demande des petits états insulaires que ce seuil a été ramené à + 1,5°C, mais on sait bien qu’au point où nous sommes arrivés, ces objectifs sont hors d’atteinte, et que si nos émissions ne ralentissent pas rapidement, nous dépasserons + 3°C. S’il fallait re-négocier ces seuils à ne pas dépasser, il est probable que nous assisterions maintenant à une âpre cacophonie. Par ailleurs, les difficultés auxquelles il faudra faire face ne sont pas tant l’augmentation des températures moyennes, que celle des températures extrêmes.
Emissions de gaz carbonique
Il faut (ou : il faudra) réduire fortement nos émissions de gaz carbonique issus de gisements de carbone fossile (et aussi de méthane, dont la concentration dans l’atmosphère augmente très vite). Mis à part l’épisode de la pandémie due au Covid19, le total de ces émissions ne cesse d’augmenter dans le monde. Il diminue cependant en Europe. L’explication est simple : une part de plus en plus grande des émissions causées par la consommation des européens a lieu dans d’autres pays, surtout en Chine, à qui nous déléguons la fabrication de nos biens de consommation. C’est pourquoi, et l’Europe elle même pousse dans cette direction, les pays doivent être jugés non pas sur les émissions de CO2 qui ont lieu à l’intérieur de leurs frontières, mais sur toutes celles qui ont servi à la fabrication de ce qu’ils consomment : les «émissions basées sur la consommation». Notre consommation de carbone fossile qu’il s’agit de réduire se niche dans de multiples ramifications. Une de celles dont on parle le plus est la voiture individuelle, dont la version à moteur thermique est peu à peu remplacée par la version électrique. Les voitures d’occasion à moteur thermique sont exportées vers les pays en développement. On oublie trop une option qui consisterait à «rétrofiter» ces voitures, c’est à dire à remplacer leur moteur thermique par un moteur électrique, en évitant ainsi les émissions qui correspondent à la fabrication de la carrosserie.
Toutes ces actions ont un coût, et pourraient idéalement être financées par de la création de monnaie, mais pour le moment, l’essentiel du financement provient de taxes ou de mesures incitatives, qu’il faudrait surveiller attentivement, ce qui est un des rôles de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) : plus des deux tiers des fonds français qui affichent des prétentions de durabilité investissent en réalité dans des entreprises qui développent de nouveaux projets de charbon, pétrole et gaz. En 2023, pour la première fois, les revenus mondiaux issus de la tarification carbone ont dépassé 100 milliards de dollars. Comment gérer ces revenus afin de les rendre les plus efficaces possible dans la réduction des émissions de carbone fossile ? La réponse n’est pas simple: une analyse de 1500 mesures dans divers pays conclut que les mesures les plus efficaces sont celles qui visent simultanément plusieurs objectifs. Et pour convaincre les gens d’agir, la justice sociale est indispensable.
Rapports GIEC
Après le sixième rapport, adopté définitivement en 2021, on entre dans le calendrier qui doit conduire à la rédaction du septième rapport du GIEC. Sa publication est en principe attendue pour 2028. Cependant, une douzaine de pays bloquant les discussions, il n’a pas été possible de trouver un accord unanime lors d’une réunion en Bulgarie où les participants étaient censés définir un calendrier de planification des actions à mener pour aboutir à cette publication. Les principaux points de conflit sont d’une part le report de 2030 à 2040 de la date d’application des mesures contraignantes de réduction des émissions, et d’autre part, le partage des efforts entre les pays développés qui ont historiquement causé la crise climatique et ceux qui n’ont fait que la subir. Faudra-t-il attendre 2029 (ou encore plus tard) pour la publication de ce rapport ?
Points de bascule du climat
Les publications scientifiques consacrent de plus en plus d’articles aux points de bascule du climat. Il s’agit du franchissement de seuils au-delà desquels le climat de certaines parties du globe ou de sa totalité pourrait changer de façon brusque et irréversible à l’échelle du siècle. Le point de bascule qui est le plus étudié est celui de la circulation méridionale de retournement dans l’océan Atlantique, dont l’arrêt modifierait radicalement le système de transfert de chaleur des basses vers les hautes latitudes. Il s’est déjà produit d’autres types de bascules depuis le début de l’interglaciaire actuel : l’aridification du Sahara, où les fresques du Hoggar et du Tibesti attestent l’existence d’une période propice à l’agriculture jusqu’en 2000 avJC, en est une qui a fait l’objet d’études nombreuses. Très récemment, il y a eu des pluies abondantes au Sahara et au sud Maroc. Est ce l’avènement d’un point de bascule ? Notons toutefois que déjà, au 16ème siècle, le Maroc a étendu son empire jusqu’à Tombouctou à la faveur d’une période pluvieuse pendant près d’un siècle, confirmée par l’accroissement de la surface des lacs situés près de Tombouctou. C’était alors l’époque du Petit Age Glaciaire. Dans tous les cas, les incertitudes sont trop grandes pour prévoir avec certitude l’occurrence d’une bascule du système climatique. De plus, les études de points de bascule se focalisent exclusivement sur le sous-système qui est susceptible de les déclencher, mais ignorent souvent les interactions à diverses échelles de temps de ce sous système avec le climat global.
Climatoscepticisme
Donner la parole à des personnes connues pour répandre des contre vérités pourrait devenir un délit. Le gendarme de l’audiovisuel (Arcom) vient de mettre en garde pour la première fois un média pour désinformation climatique. En effet, le collectif Quota Climat a saisi cette autorité à l’encontre de Sud Radio à la suite d’une interview du très controversé François Gervais, chimiste, et surtout, climatosceptique, dont les thèses sont dénuées de fondement scientifique. Cette émission minimisait ou contredisait le consensus scientifique autour du changement climatique et l’Arcom a émis un avertissement à l’encontre de Sud Radio. En cas de récidive, cette station risque une mise en demeure, puis une sanction financière. Une première !
Elon Musk et le changement climatique
L’entretien récent de Donald Trump avec Elon Musk a été publié sur Internet. On y lit que la limite que pose Elon Musk concernant le changement climatique est que la concentration en gaz carbonique n’atteigne pas 1000 parties par million, au-delà de quoi on respire mal et on est victimes de maux de tête. Nous n’en sommes qu’à 425 parties par million, et les pires scénarios examinés par le GIEC, si nous sommes raisonnables, ne devraient pas nous conduire à de tels niveaux : nous aurions alors à faire face à bien d’autres calamités. Mais de 425 à 1000, cela ne laisse-t-il pas place à une exploitation débridée des hydrocarbures fossiles et à des années de business effréné et enrichissant ? Elon Musk se déclare aussi en faveur des cryptomonaies, dont sait qu’elles sont très consommatrices d’énergie. Souhaitons qu’un tel binôme ne vienne pas à présider aux Etats Unis!
Modification de la rotation de la Terre
Quoi de plus enivrant pour qui étudie les mouvements des fluides à la surface de la Terre que de savoir que ces mouvements modifient la vitesse de la rotation de la Terre solide autour de son axe, et par conséquent la durée du jour. Les réajustements de l’écorce terrestre qui s’opèrent lors de tremblements de terre induisent aussi des sauts de la durée du jour. Il y a environ 20 ans, on observait qu’il y avait une très forte corrélation entre la vitesse de rotation de la Terre et le moment cinétique de l’atmosphère. A 10 ans d’échéance, la corrélation diminuait et on attribuait cela aux interactions (mal connues) entre le manteau et le noyau terrestres. Dans ces réflexions, l’océan ne jouait aucun rôle détectable (était ce faute d’en connaître la circulation ?). Glaces, masses d’eau, systèmes de vents, tous agissent en même temps, et les effets sur la durée du jour sont minimes (de l’ordre de la milliseconde). La fonte des glaces a un effet inverse selon qu’il s’agit des glaciers tropicaux (dont après fusion la masse perd de l’altitude et se rapproche de l’axe de rotation de la Terre) ou des calottes polaires (dont l’eau de fusion s’éloigne de l’axe de rotation en dérivant vers l’équateur). En El Niño, le ralentissement des courants équatoriaux vers l’ouest est de nature à ralentir la rotation de la Terre. Est-ce l’inverse en La Niñà ? probablement, mais alors, un autre phénomène intervient : l’accumulation d’eau dans le Pacifique tropical nord-ouest (la «Warm Pool») fait se déplacer l’axe des pôles. Alors que la durée du jour augmente lentement inexorablement dans les temps géologiques, depuis une dizaine d’années, elle tend maintenant plutôt à diminuer, tandis que l’emplacement du pôle qui décrivait une trajectoire plus ou moins périodique et régulière se déplace maintenant en ligne droite.
Avril 2023, augmentation brusque de la température moyenne de la Terre, quelles causes ?
Lorsque, en avril 2023, la température moyenne globale a brusquement augmenté, très au dessus des valeurs des années précédentes, et alors que le dernier évènement El Niño n’avait pas encore débuté, l’éruption récente du volcan Hunga Tonga dans les îles Tonga dans le Pacifique sud a semblé une explication plausible, le mécanisme invoqué étant l’injection dans la stratosphère d’une grande quantité de vapeur d’eau qui y augmenterait durablement l’effet de serre. Il est maintenant possible de dresser un bilan de cet épisode, et il apparaît que le rôle de cette injection de vapeur d’eau dans la stratosphère a été contrecarré par l’injection simultanée d’aérosols soufrés provenant de la même éruption, et qui sont connus pour refroidir le climat durant un ou deux ans, comme cela s’est passé après l’éruption du volcan Pinatubo aux Philippines en 1991, et, plus loin dans l’histoire, celle, terrible, du Tambora en 1815. Une cause certaine du réchauffement est l’interdiction de l’usage du fuel contenant du soufre dans le transport maritime, à la suite de quoi la concentration en aérosols de l’atmosphère a chuté, facilitant la pénétration du rayonnement solaire jusqu’à la surface de la Terre. Mais cela ne suffit pas à expliquer la brusque hausse de la température moyenne globale en 2023. Brusque… et anormale ? Ou simplement due aussi aux émissions de gaz carbonique ?
Une video spectaculaire a été diffusée par la NASA. Elle montre les émissions de gaz carbonique et leur transport dans l’atmosphère en hiver dans l’Amérique du nord, puis plus généralement sur tout le globe. Il n’y a là rien de bien nouveau : la carte (« le cadastre ») des émissions est connu, et il est ici couplé à un modèle de transport atmosphérique, le tout à très fine échelle. Les émissions dans l’est de l’Amérique du nord en hiver (industries, chauffage domestique) sont impressionnantes. L’alternance quotidienne source/puits de gaz carbonique des forêts tropicales, due au cycle photosynthèse /respiration, est un autre aspect bien rendu de cette vidéo.
Le glyphosate qui pollue les rivières et les nappes phréatiques n’aurait pas une origine seulement agricole : les eaux usées des villes en contiendraient de façon quasi permanente, ce qui ne correspond pas au rythme saisonnier auquel l’agriculture utilise cet herbicide. Ne s’agirait-il pas là d’une manœuvre de diversion pour attirer l’attention ailleurs que sur les usages agricoles ? Le "roundup" est maintenant interdit, mais il est, dit-on, assez facile de se procurer les produits qui permettent d’en fabriquer.
Tout comme la température moyenne globale, le contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère augmente. Le graphique ci dessous représente cette augmentation d’année en année, et on note un brusque décrochement vers des valeurs élevées en 2023, année qui a aussi vu une brusque augmentation de la température. L’augmentation de 1 kg m-2 pour une valeur moyenne annuelle de l’ordre de 25 kg m-2 serait donc de 4 % environ, ce qui est supérieur à ce qu’on peut calculer en se basant sur un saut de la température moyenne globale d’environ 0,3°C. Noter le très net cycle saisonnier avec un maximum de contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère globale au mois d’août. Ces estimations du contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère sont essentielles pour l’étude du climat car elles sont indispensables pour corriger beaucoup de mesures par satellite.

Attention : le puits de carbone dans la végétation en France se dégrade. C’est un constat qui se confirme à chaque rapport. Cette fois, c’est la conclusion de travaux menés par Solagro, rapportés par Christian Couturier qui fut président de NEGAWAT. La forêt française a stocké 28 millions de tonnes de gaz carbonique en 2022. Mais cette capacité d’accumulation a été réduite de 60% par rapport à la moyenne 2005-2015. Le mauvais état des forêts française signifie que le puits de carbone qu’on en attend est largement surestimé et que pour atteindre le net zéro émissions, il faudra trouver autre chose. L’une des erreurs les plus manifestes est la filière bois énergie, très mal contrôlée.
Des panneaux solaires à géométrie variable.
Disposés de façon à capter un maximum d’énergie solaire, ils entrent en compétition avec l’usage agricole des terres. Toutefois, des projets qui permettent un usage mixte des surfaces pour l’agriculture et pour la capture de l’énergie solaire se multiplient. Au départ des projets, il y a en général une démarche des sociétés qui installent les panneaux et qui cherchent des sites favorables. L’agriculteur contacté est souvent en position de faiblesse dans ces négociations, où, pourtant, il conviendrait de trouver une solution optimale pour les deux partenaires. Les plantes ont besoin de lumière mais en été, pour plusieurs cultures, cette lumière arrive en trop grande quantité, de telle sorte que des panneaux solaires judicieusement installés peuvent s’avérer profitables pour les deux partenaires. Il existe maintenant des panneaux à rendement très élevé qui non seulement captent le rayonnement en provenance du Soleil, mais aussi le rayonnement infra-rouge émis par le sol sous-jacent. Et pourquoi ne pas élever des canards en plein air sous les panneaux solaires ?
.............
Juin 2024
2021-2023 sécheresse en France, 2024 pluies abondantes
Quel est dans ces deux cas le rôle du changement climatique ? S’il est une loi physique que les médias et le public semblent avoir bien apprise et répètent à chaque occasion, c’est bien la loi de Clausius-Clapeyron, selon laquelle la quantité de vapeur d’eau que peut contenir l’atmosphère augmente de 7 % lorsque la température augmente d’un degré Celsius. Cela étant acquis, certains en concluent que ce taux de 7 % s’applique aussi à l’évaporation et aux précipitations : c’est faux. Le contenu de vapeur d’eau de l’atmosphère est une masse, alors que l’évaporation et les précipitations sont des flux, et cette masse peut rester inchangée quels que soient les flux, à condition qu’ils s’équilibrent. Selon le modèle de Manabe, le taux de saturation de l’atmosphère en humidité ne change pas malgré le réchauffement du climat, et ce réchauffement entraîne donc bien une augmentation du contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère de 7 %, avec, entre autres conséquences, celle de multiplier par 2 l’effet de la teneur en gaz carbonique sur la température moyenne globale. Manabe a reçu le prix Nobel de Physique en 2021 et son modèle est celui qui est utilisé dans les modèles climatiques actuels. L’augmentation de l’évaporation à l’interface entre l’océan et l’atmosphère ne serait, selon les estimations des modèles, que de + 2 %, et les conséquences sont très variables selon les régions. Une étude récente révèle que les pluies d’automne et d’hiver en Irlande et en Angleterre se sont accrues de 20 % à cause du réchauffement climatique : c’est beaucoup plus que 7 % par °C. La cause principale serait un déplacement du système des zones de haute et de basse pression atmosphérique dans l’Atlantique nord (symbolisé par la différence de pression entre les Açores et l’Islande, représentée par l’indice NAO (North Atlantic Oscillation). Les pluies extrêmes, en particulier les pluies d’orage, dépendent des mouvements ascendants de l’air humide dans les systèmes convectifs. Dans ces systèmes, la chaleur libérée lors de la condensation de la vapeur d’eau joue un rôle moteur : dans ces situations, davantage de vapeur d’eau dans l’atmosphère intensifie les mouvements ascendants, et la rétroaction positive ainsi mise en place peut entraîner des pluies très intenses. On voit dans ces deux exemples que le changement dans les régimes de pluies ne suit pas la règle des + 7 % / °C.
Une contrainte pour estimer globalement le transfert de vapeur d’eau des océans aux continents pourrait être fournie par le retour de l’eau douce à la mer, c’est à dire le cumul des débits de rivières, ces deux termes devant se compenser au moins approximativement. Grâce surtout aux hydrologues russes sous la direction de Shiklomanov au siècle dernier, les débits des grands fleuves et des rivières ont été enregistrés ou relevés régulièrement. Les données ainsi collectées ont permis d’estimer à environ 1 million de m³/s le débit global des fleuves. Cette estimation a été rehaussée à 1,1 millions de m³/s par les français Pardé, puis Ghislain de Marsily, à partir essentiellement de ces mêmes données compilées par les russes. Les réseaux d’observations des débits des cours d’eau ont en grande partie été abandonnés, et il n’est hélas pas possible d’observer un changement dans ce cumul qui serait causé par le changement climatique. Le lancement récent du satellite SWOT et les résultats très prometteurs qu’il fournit déjà pourraient permettre désormais un suivi de l’état des bassins fluviaux et de leur débit.
Les sécheresses mettent progressivement en route une cascade de conséquences
Utilisant une synthèse de nombreux travaux sur les épisodes de sécheresse dans trente trois bassins hydrologiques d’Afrique, une étude s’est penchée sur l’enchaînement des dommages causés. Les sécheresses affectent successivement l’humidité des sols, la végétation et les cultures, les débits des cours d’eau et les nappes phréatiques. Cette propagation de la sécheresse jusqu’à la totalité des paysages suit un schéma en cascade qui en relie les conséquences les unes aux autres. Les analyses des séries temporelles d’observations de tous ces bassins montrent de fortes similitudes : les manques de précipitations conduisent immédiatement à un déficit d’humidité des sols, puis après un mois, la végétation souffre, et au bout de deux mois, l’ensemble du système hydrologique est affecté.
Des grands canaux pour distribuer l’eau
Acheminer l’eau du Rhône vers le Languedoc est un vieux projet, Aqua Domitia, qui a connu des hauts et des bas. Vers 1997, il a même été envisagé d’aller jusqu’à Barcelone, qui manquait d’eau, mais la difficulté du franchissement des Pyrénées a vite fait abandonner cette extension. Actuellement, l’eau du Rhône arrive jusqu’à Montpellier par canal ouvert, et jusqu’à Béziers par conduite fermée. La très longue sécheresse qui sévit dans le Roussillon a redonné de l’élan à Aqua Domitia : les conduites d’eau seront prolongées jusqu’à l’Aude et les Pyrénées Orientales. Le développement de nombreux pays dans le monde offre une foule d’exemples de tels aménagements, certains très anciens : le pont du Gard, Assouan, etc... Un canal amène l’eau du nord de la Californie vers le sud. Les premiers grands travaux soviétiques ont été des travaux hydrauliques toujours source de fierté pour les peuples.
Le "Net Zero Emissions" en 2050 est-il possible ?
Plusieurs d’entre nous ont assisté à un séminaire sur ce thème. La tonalité générale était que réduire les émissions de carbone en Europe (où, plus largement dans les pays développés) coûtait beaucoup plus cher par tonne de CO2 évitée que dans les pays en développement. Selon cette logique, il serait donc plus facile de diriger les efforts de réduction d’émissions vers ces derniers. De plus, au rythme auquel les nations européennes réduisent leurs émissions, celles ci seront en quantité négligeable en 2050, et alors, le problème sera chez les pays nouvellement gros émetteurs. L’assistance semblait favorable à cette ligne, et peu consciente du risque grandissant de voir des régions entières devenir invivables à cause du réchauffement du climat. Heureusement, les émissions de gaz carbonique baissent en Europe, et il en est de même chez le plus gros émetteur : la Chine, qui semble respecter ses engagements.
Les forêts en souffrance : leur efficacité dans la capture du CO2 en déclin
Les spécialistes des forêts se creusent la tête pour trouver quelles espèces d’arbres pourront assurer un piégeage efficace du gaz carbonique de l’atmosphère, tout en résistant aux canicules, aux sécheresses, et aux insectes xylophages, et tout en assurant des revenus aux exploitants forestiers. On en vient sur le plateau de Millevaches à planter des variétés de pins corses. Une autre contrainte apportée par le changement climatique est que le démarrage des bourgeons au printemps se fait de plus en plus précoce, alors que le risque de gelées tardives reste entier. Ces gelées tardives obligent les arbres à bourgeonner de nouveau plus tard, et ceci raccourcit la durée de la végétation et réduit la croissance des arbres.
En France, la législation ne favorise pas toujours un développement optimal de la forêt. L’état, par exemple, au prétexte du « plan vert », incite les propriétaires de bois à couper sans limite, et finance sans contrôle la replantation. Résultat, la plupart du temps, ce sont des pins qui sont replantés. Incendies, sécheresse et insectes xylophages s’y ajoutant, la forêt française capte moins de carbone qu’au cours des décennies précédentes, malgré une superficie en augmentation. Ce déclin du puits forestier de carbone n’est pas propre à la France : l’Amazonie a subi des sécheresses en 2007, 2010 et 2015. Toutes les régions du globe ne montrent pas un tel déclin, mais dans l’ensemble, le puits de carbone dans la végétation n’est plus aussi prometteur qu’on le pensait il y a 20 ans.
Changement climatique : faut il envisager le pire ?
Canicules, inondations et incendies sont de plus en plus intenses et fréquents. Cela était annoncé régulièrement à chaque parution des rapports du GIEC, et n’est donc pas une surprise. Pablo Servigne il y une dizaine d’années, dans son livre « Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes » a alerté sur les risques d’enchaînement des catastrophes et d’effondrement, mais on se comporte comme si on saurait éviter cela le moment venu. Un article paru dans PNAS considère que l’éventualité de ce risque majeur est insuffisamment étudiée et propose que l’on s’interroge sur quatre points :
- le changement climatique peut il conduire à des extinctions de masse ?
- Quels sont les mécanismes qui pourraient donner lieu à des mortalités massives chez les humains ?
- Quels risques entraîneraient pour les sociétés humaines des dommages initiés par le changement climatique ?
- Comment en considérant tous ces dangers élaborer un instrument d’aide à la décision ?
Il faudra un jour prendre cela au sérieux.
Des politiques et des scientifiques
Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a été mis sur pied pour formuler des recommandations à l’adresse du ministre de l’Éducation nationale, afin de modifier les programmes d’enseignement de l’école et du collège de telle sorte que le changement climatique y soit expliqué. Pour cela, le CSP a écouté 22 experts sur le climat. Stupeur : l’un d’entre eux, François Gervais, est un climatosceptique notoire, militant du climatoscepticisme, et qui n’a aucune compétence dans les disciplines de la climatologie. Qui a pu vouloir l’écouter ?
Alors, pour nous venger, rions un peu des politiques. Lors d’une réunion portant sur les énergies renouvelables, le représentant de l’ex Haute Volta, devenue Burkina Fasso (lui même, voltaïque, devenu Burkina-Bé), a demandé paraît-il qu’on remplace dans les rapports le terme « photovoltaïque » par « photoburkinabé ». Autre perle, en France, à un expert qui lui rétorquait que sa proposition n’était pas acceptable en raison de la loi de Carnot, ce député qui avait pourtant suivi une scolarité digne d’un pays développé, répondit : « si une loi est un obstacle, il n’y a qu’à l’abroger » !
Le satellite EarthCARE a été lancé
Ce satellite européen et japonais vise à recueillir des données sur les nuages et les aérosols. Ses points forts sont :
- un imageur multispectral pour les nuages, doté d’un champ plutôt étroit, et dont les deux instruments sont au nadir,
- un instrument pour le bilan radiatif qui regarde à deux angles différents le long de la trace, et
- un radar doppler et un lidar pour mesurer la vitesse verticale de l'air ainsi que les profils verticaux d'eau liquide et solide dans les nuages.
Les aérosols sont une composante du système climatique insuffisamment observée après l’arrêt accidentel de l’instrument Polder et celui du satellite PARASOL. Ces deux derniers permettaient des mesures de polarimétrie sur les aérosols, et on peut regretter que EarthCARE ne soit pas équipé d’un polarimètre.
Mai 2024
Justice et transition écologique
De nombreux états ont signé l’accord de Paris pour le climat. Il reste encore à y donner suite en prenant les mesures indispensables pour ralentir le changement climatique, et là, l’action des états est beaucoup trop lente. Cependant, si les états sont souverains, ils ne sont pas à l’abri de poursuites judiciaires, et la Cour Européenne des Droits de l’Homme est de plus en plus sollicitée pour cela : la Bulgarie, les Pays Bas, l’Allemagne, la Belgique, ont ainsi été condamnées, et aussi la France lors de ce qu’on a appelé «l’affaire du siècle». La dernière condamnation en date a été prononcée contre la Suisse, après la plainte portée par un collectif de 2 500 Suissesses de 73 ans en moyenne : les «Aînées», au titre que leur grand âge les rendait particulièrement sensibles aux méfaits du réchauffement climatique.
Finance et transition écologique
Le monde de la finance se préoccupe-t-il des risques dûs au changement climatique ? Obnubilé qu’il est par le profit, et dominé par l’International Sustainability Standards Board (ISSB) et les normes comptables que sont les International Financial Reporting Standards, il ne prend le changement climatique en considération que dans la mesure où celui ci peut nuire aux profits financiers. Cette attitude est celle des États Unis, puissance dominante du monde financier, et paraît bien ancrée. Cependant, en Europe, une autre approche se fraye un chemin : sous la dénomination de «Double Matérialité», elle consiste à prendre en compte en plus des dégâts que le climat peut faire à la finance (les seuls que considère l’ISSB), ceux que la finance peut faire au climat. Et l’Europe n’est plus seule à tenter de mettre cette double matérialité en avant : la Chine, suivant en cela la recommandation de l'Asia Investor Group on Climate Change, a décidé récemment de se mettre en porte à faux avec l’ISSB en adoptant elle aussi la Double Matérialité.
La santé des océans
La conférence internationale "Our Ocean" vient de se tenir à Athènes. La Grèce, pays hôte, a marqué cette conférence en annonçant l'interdiction du chalutage de fond dans toutes ses aires marines protégées, et en augmentant en nombre et en étendue ces aires marines protégées. Une fois ces aires décrétées, le problème est de les faire respecter, et là, en général, les moyens de surveillance manquent. Un débat est en cours, en France notamment, pour savoir s’il vaut mieux quelques grandes aires marines protégées, ou beaucoup de petites : pour ce qui est de la préservation des ressources et de la biodiversité, la réponse semble pour le moment en faveur de la deuxième solution.
Un phénomène nouveau a été observé : des upwellings (remontées jusqu’en surface d’eaux profondes plus froides) se produisent parfois là où ils n’existaient pas avant le changement climatique en cours. Pour les espèces inféodées à des eaux chaudes, ces upwellings nouveaux peuvent constituer des pièges.
Aérosols, pas simple...
La décision mise en application en 2020 de réduire les émissions d’aérosols soufrés par le transport maritime a eu une forte incidence sur la teneur en aérosols de l’atmosphère, notamment en Atlantique nord, et ceci a stimulé les recherches sur le rôle climatique des aérosols. Globalement, ceux ci réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l’espace et tendent donc à refroidir le climat, comme cela se produit lors des éruptions volcaniques majeures (le philipin Pinatubo en 1992, le mexicain El Chichon en 1982, et, en remontant dans l’histoire, l’indonésien Tambora en 1815 et l’islandais Laki en 1785). Mais l’action des aérosols, en se combinant avec celle de la vapeur d’eau, est plus complexe : ils sont des noyaux de condensation, et aussi des noyaux glaciogènes, et les gouttelettes ou cristaux ainsi formés ont un effet sur le transfert radiatif et sur la dynamique des nuages. Complexité que traduit bien cette saillie de John Mason, spécialiste de la microphysique des nuages, lors d’un exposé auquel a assisté un Argonaute encore étudiant : «si le climat dépend vraiment de la microphysique des nuages, alors, que Dieu nous vienne en aide». Certains aérosols (les suies notamment, en Inde en particulier) sont absorbants, et dans les nuages bas, en absorbant le rayonnement, ont un rôle important sur la dynamique de ces nuages. Les poussières désertiques, notamment celles constituées d’argile, ne constituent pas des noyaux de condensation, mais, des noyaux glaciogènes, qui aboutissent à des cirrus denses, dont l’effet est réchauffant. Au début du mois d’avril, la Météo allemande prévoyait un grand ciel bleu et 22°C, or, la couverture de nuages était totale et la température n’a été que de 15°C. En cause : des cirrus épais (DIBS : Dust-Infused Baroclinic Systems) induits par la poussière, et non pas des nuages bas. Ces cirrus ont été assez réfléchissants pour avoir eu un impact refroidissant en surface. On manque d’observations sur les aérosols. La situation devrait s’améliorer bientôt avec le lancement du satellite américain PACE , avec le EarthCARE européen, et aussi avec un projet de satellite chinois.
La température moyenne globale : les records s’enchaînent
Mars 2024 a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, et s’ajoute à la suite de neuf précédents records mensuels d’affilée. Les températures anormalement élevées ont particulièrement touché l’Europe, l’est de l’Amérique du nord, le Groenland, l’est de la Russie, l’Amérique centrale, plusieurs zones d’Amérique du sud et d’Afrique, le sud de l’Australie et plusieurs régions du continent Antarctique. Qu’en sera-t-il, une fois l’épisode El Niño terminé, pour l’été 2024 ? Les prévisions basées sur le mois d’avril s’avèrent souvent peu fiables (on appelle cela le «tunnel d’avril»). Elles promettent des températures élevées dans le sud-est de la France, tandis que le nord-ouest sera chaud, mais pas exceptionnellement. Les sols humides après les pluies abondantes de ce printemps tendront à retarder l’installation de périodes chaudes.
Dessaler l’eau de mer pour pallier au manque d’eau : fausse bonne solution
Barcelone manque d’eau douce. La menace n’est pas nouvelle et déjà, dans les années 1990, il a été envisagé d’y acheminer l’eau du Rhône par un canal : c’est le projet Aqua Domitia qui a été abandonné à cause du coût du franchissement des Pyrénées et aussi d’oppositions d’agriculteurs du Languedoc. Dès 2009, pour y pallier, Barcelone s’est dotée d’une usine de dessalement d’eau de mer située dans la banlieue sud à El Prat del Llobregat. Et qui produit environ 20 000 mètres cube d’eau douce par jour. Au mois d’avril dernier, la Catalogne à décidé d’implanter une nouvelle usine de dessalement de l’eau de mer, capable de satisfaire 6 % des besoins de Barcelone. Celle ci sera flottante, installée sur un paquebot dans le port de la ville. 12 autres usines de dessalement sont prévues sur la côte de Catalogne, notamment pour satisfaire les besoins de l’industrie touristique. De telles usines se sont multipliées partout dans le monde dans les pays soumis à des sécheresses. Outre le fait qu’elles sont très énergivores, elles rejettent aussi en abondance des saumures très concentrées, plus chaudes que l’eau de mer utilisée, et enrichies en divers produits (anti algues, antifouling etc.). Les conséquences de ces rejets pour la biodiversité des eaux côtières n’ont pas encore été bien évaluées.
La verte contrée qui a fait rêver les Vikings
Le Groenland a été ainsi nommé parce qu’à l’époque où il a été habité par des Vikings, il était réputé verdoyant et propice à une agriculture rudimentaire. L’histoire plus récente évoque plutôt le blanc des neiges et des glaciers. Cependant, avec le réchauffement climatique, la végétation s’y réinstalle, et des saumons se reproduisent maintenant dans les rivières du Groenland. S’agit-il du début de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, avec pour conséquence, une montée de plusieurs mètres du niveau des océans ? Pas encore : ces rivières et ces pentes qui se végétalisent sont situées à basse altitude, au bord de la mer, tandis que l’essentiel de la calotte glaciaire se situe en altitude, dans une cuvette au centre du Groenland.
Les carburants pour demain
L’hydrogène est souvent présenté comme une excellente solution pour stocker et utiliser les énergies renouvelables. Mais qu’en faire si les stations service n’en proposent pas, si le marché n’est pas organisé ? En France, c’est l’aviation qui tire le plus vers cette solution, basée sur de l’hydrogène liquide. Mais ceci nécessite pour les avions un réservoir très volumineux (toutefois cependant moins pesant que pour les autres carburants car l’hydrogène est très léger). À côté de l’hydrogène, ne devrait on pas s’intéresser davantage aux carburants de synthèse qu’on peut produire avec des énergies renouvelables (éventuellement en empruntant du CO2 capté dans l’atmosphère). En effet, une voiture qui roule à l’hydrogène fait trois fois moins de chemin que si elle utilise l’électricité utilisée pour produire cet hydrogène. Des alternatives existent : méthane, carburants de synthèse. Et si on s’orientait vers ces carburants de synthèse, pourquoi ne pas en faire profiter l’automobile ? Il y a en effet une clause de réexamen en 2026 de la décision européenne d’arrêter la production des véhicules thermiques en 2030.
Et si les câbles sous marins rendaient service à l’océanographie ?
Les câbles sous-marins sont nombreux à travers les bassins océaniques, et ils ne sont pas utilisés par l’océanographie. Ceci pourrait changer, car il y a en projet (IFREMER, partenaires industriels américains) d’instrumenter les câbles sous-marins du réseau internet. Dans un premier temps, ces équipements concerneraient les câbles à installer, et plus tard, ceux déjà installés. Les capteurs envisagés sont principalement des capteurs de pression qui permettraient une observation très précise et en temps réel de la hauteur des vagues. Une première installation est envisagée entre l'Australie et la Nouvelle Calédonie. Un projet est à l’étude avec le Portugal sur des câbles déjà installés, avec relais de la transmission des données par des bouées instrumentées. La Woods Hole Oceanographic Institution aux États-Unis a aussi un projet analogue dans l’Océan Arctique.
-------------------------------------
Ghislain de Marsily nous a quittés le 21 avril. Bien connu de plusieurs Argonautes, respecté et aimé, il a été un animateur passionné de l’hydrogéologie en France. Conformément à sa volonté, le Club des Argonautes fera un don à l’association «La main à la pâte» dont il partageait la passion pour la diffusion des connaissances scientifiques.
Lecture recommandée : Sous forme de BD «horizons climatiques - Rencontre avec neuf scientifiques du G.I.E.C.» interviews de Valérie Masson Delmotte, Christophe Cassou, Roland Séférian, Hervé Douville, Wolfgang Cramer, Virginie Duvat, Céline Guivarch, Henri Waisman, Jean Jouzel.
Avril 2024
À l’écoute des conférences et séminaires
Avec l’usage maintenant très répandu des outils de communication qui permettent d’assister depuis chez soi à des conférences ou séminaires, nous avons accès presque chaque jour à des exposés diffusés depuis les quatre coins du monde : cette fenêtre ouverte permet de suivre en direct l’avancée des connaissances scientifiques.
L’Académie des Sciences à organisé au début du mois de mars un colloque intitulé "l'urgence climatique: un-tournant décisif ". Les exposés, par des conférenciers parmi les mieux connus sur des sujets dont nous parlons souvent, étaient tous d’une qualité remarquable et ont fait le point sur l’état du climat et de ses composantes, et sur les évolutions à prévoir en fonction de nos décisions futures. L’Académie des Sciences a donc définitivement tourné la page après une trop longue période, où des scientifiques climatosceptiques ont pu s’exprimer en son sein.
Un webinaire du programme de recherche TRACCS -Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques– était consacré à l’Étude des épisodes méditerranéens de pluie intense : une approche par la modélisation climatique aux échelles kilométriques. À la question « l’intelligence artificielle, scrutée en permanence par les médias, peut elle aider à mieux comprendre et prévoir ces épisodes ? » il a été répondu que les observations pour permettre un apprentissage machine efficace sont encore trop peu nombreuses pour cela.
La dernière conférence du Bureau des Longitudes était consacrée à l’étude des « Déformations à la surface de la Terre : zoom et dé zoom avec l'interférométrie radar ». Si l’interférométrie radar a pu se montrer utile en certains sites pour la prévision et le suivi des éruptions volcaniques, les séismes résistent toujours à la prévision. Cette question n’a rien à voir avec l’étude de l’atmosphère, mais partage avec les atmosphériciens l’objectif de prévoir les catastrophes naturelles. Toutefois, climat et éruptions volcaniques pourraient bien avoir été liés à certaines époques de l’histoire de la Terre : à la fin de la dernière glaciation, chaque épisode de montée rapide des océans a été marqué dans les sédiments marins par l’abondance de cendres volcaniques. La cause probable est que la fonte rapide des calottes glaciaires pendant ces épisodes a déstabilisé l’équilibre isostatique de la croûte terrestre et provoqué des éruptions volcaniques plus nombreuses.
Cet hiver 2023-2024 a été fertile en records de chaleur, chaque mois étant le plus chaud en moyenne de la Terre entière depuis que le climat est observé. Pour expliquer cette hausse exceptionnelle des températures, trois évènements sont mis en avant : le déclenchement d’un épisode El Niño en mai 2023 (mais le réchauffement avait débuté avant), l’injection massive de vapeur d’eau dans la stratosphère suite à l’explosion du volcan Hunga Tonga, qui renforce l’effet de serre de l’atmosphère (mais l’explosion a aussi injecté des poussières qui réfléchissent le rayonnement solaire et tendent donc, au contraire, à refroidir le climat), et la réduction des aérosols dans les zones de trafic maritime suite à l’interdiction des carburants soufrés par les navires. Mais ces causes ne suffisent pas à expliquer en totalité la hausse des températures. Bien que très élevée, cette hausse reste cependant dans la fourchette des prévisions des modèles climatiques : si 2024 retrouve des valeurs conformes à celles des années précédentes, de 2010 à 2022, il se sera agi de variabilité naturelle du climat. Si la hausse de 2023 se maintient, la question d’une tendance plus forte que prévu sera posée.
La transition écologique : des grincements.
L’application des mesures annoncées pour lutter contre le changement climatique ne soulevait pas l’enthousiasme, mais semblait jusqu’à la fin 2023 ne pas rencontrer d’opposition forte. Le plan de formation des fonctionnaires par exemple, dont nous avons suivi l’élaboration, paraissait accepté dans ses grandes lignes. Le changement toutefois n’était pas assez rapide, comme l’a souligné récemment le Haut Conseil pour le Climat dans une lettre au Premier Ministre. Le mécontentement des agriculteurs dans toute l’Europe a été une douche froide : il faudra avancer avec beaucoup de prudence et de patience, et même souvent, reculer. Pire, les partis politiques délaissent ce thème de peur de perdre des électeurs. Les résultats des élections à venir, en Europe ou aux États Unis, sont incertains, et n’incitent pas à l’optimisme.
Si les efforts sont mal adaptés au niveau des états, ils semble que les discussions se passent mieux au niveau des collectivités. C’est ce qu’indique une étude sur la mise en œuvre de l'adaptation au changement climatique conduite à Saint Pierre et Miquelon. Là, plus que les postures politiques, c’est la nécessité de résoudre ensemble des problèmes que l’on partage, et la confiance entre la population et les organisations et responsables locaux, qui sont déterminants.
Fuite en avant vs juste besoin
On rapporte des réunions au cours desquelles d’anciens élèves de grandes écoles rejettent les mesures contraignantes pour faire face au changement climatique et objectent qu’il suffit d’envoyer dans l’atmosphère des aérosols, ou d’appliquer d’autres solutions technologiques. La mise en œuvre de techniques de géoingéniérie pour lutter contre le changement climatique divise la communauté scientifique. Ainsi, James Hansen de l’Université de Columbia aux États Unis, craint que quels que soient nos efforts pour réduire nos émissions de gaz carbonique, nous ne parviendrons pas à maintenir la hausse des la température moyenne globale au dessous de 1,5°C, ni même au dessous de 2°C. Pour rester à des niveaux de réchauffement acceptables, il faudrait donc recourir sans attendre à des techniques de géoingéniérie : atténuation du rayonnement solaire par des aérosols injectés dans l’atmosphère, enfouissement du gaz carbonique dans des gisements d’hydrocarbures épuisés, et autres techniques. Pour Michael Mann de l’Université de Pennsylvanie, les techniques de géoingéniérie sont mal maîtrisées et ne sont pas sans danger. De plus, les mettre en avant donne l’illusion que des solutions techniques corrigeront nos comportements de gaspilleurs d’énergie, et qu’il n’y a pas péril en la demeure.
À un niveau plus local, l’usage du bois comme source d’énergie « verte » a été brandi comme une solution viable. Cela peut être vrai à condition de veiller à ne pas aller au-delà de la faculté des forêts à se régénérer. Mais on voit se développer des projets de grandes dimensions qui gaspillent la ressource. Ainsi, les centrales à bois de Gardanne en France, et de celle du groupe Drax au nord du Yorkshire en Angleterre, fonctionnent à coups de subventions avec du bois importé de très loin, de forêts d’Eucalyptus au Brésil par exemple. Ce gaspillage est inquiétant, alors qu’il faudrait ancrer dans la société la notion de juste besoin.
Pénurie d’eau douce et mesures de préservation
La sécheresse s’installe dans le pourtour méditerranéen, comme l’indique la carte ci dessous produite par le Service Copernicus. Les déficits en eau en moyenne relative (en marron) et excédents (en bleu) ne concernent que la première dizaine de centimètres du sol à un moment donné, mais s’inscrivent dans une longue série, année après année, de déficits de pluie dans le bassin méditerranéen.
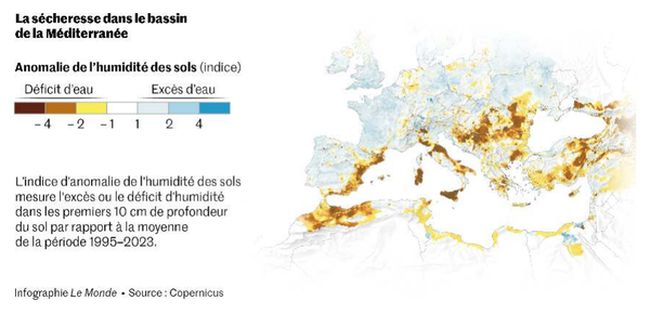
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c4e6816d-d219-11ee-b9d9-01aa75ed71a1/language-en)
Comment s’y adapter ? Le manque d’eau dans la région de Barcelone fait penser au projet Aqua Domitia, qui consistait à y amener l’eau du Rhône. Ce projet n’a pas abouti, à cause du coût trop élevé du franchissement des Pyrénées, et de réticences locales, et il s’est arrêté à Béziers. Le prolonger jusqu’à l’Aude et les Pyrénées orientales frappées par la sécheresse est à l’étude. Souvent, les besoins sont modestes, et il suffit alors de disposer d’un réservoir, que l’on remplit avec l’eau de pluie qui tombe sur les toitures. Au Kirghizstan, si les conditions s’y prêtent, il n’est même pas besoin de disposer d’un réservoir : en zone montagneuse en hiver, une conduite d’eau depuis un lac déverse de l’eau à proximité d’un village, où elle gèle rapidement sur place, formant un mini-glacier qui perdure jusqu’à l’été. Cette solution bon marché, qui est également mise en œuvre dans d’autres pays où les conditions sont analogues, est préconisée, en particulier pour fournir de l’eau en été au bétail. Elle apporte aussi localement fraîcheur et humidité là où les étés peuvent être torrides.
Énergie : du plus fou au plus raisonnable
L’Arabie Saoudite manque d’eau, et souhaiterait elle aussi varier son approvisionnement en énergie, actuellement trop marqué par le recours quasi exclusif au pétrole. Le vent n’y manque pas, ni l’ensoleillement. Un projet gigantesque est à l’étude, dans lequel intervient EDF. Il s’agit de créer et d’alimenter une réserve d’eau (de mer) à une altitude suffisante par pompage, en utilisant de l’énergie éolienne et solaire, pour ensuite laisser cette eau s’écouler et faire tourner des turbines pour produire de l’électricité. Le principe est analogue à ce qui se pratique (STEP : station de transfert d'énergie par pompage) dans plusieurs sites hydroélectriques en France, où il permet d’harmoniser la production et l’usage de l’électricité. En Arabie Saoudite, les potentiels de production d’électricité éolien et solaire existent, mais comme ailleurs, ils sont irréguliers. Le dispositif d’un réservoir d’eau surélevé permettrait de pallier à cette intermittence. Mais le projet laisse pensif par ses dimensions : il serait associé à une mégalopole de 26 000 km² construite en plein désert, avec station de ski, et une « ville-gratte-ciel » de 500 m de hauteur et 170 km de longueur !
Après une telle ambition, un projet de récupération de chaleur dans le métro de Rennes à usage de chauffage domestique paraît peu de chose. Il vaut pourtant la peine qu’on s’y intéresse, pas seulement pour les calories qu’il permettra d’extraire du sol en hiver, mais surtout parce qu’il a été conçu avant la construction de la ligne de métro. En effet, pour de tels systèmes à basse énergie, il faut des infrastructures de grandes dimensions pour une production de chaleur modeste. Ouvrir un chantier pour cela sur une ligne de métro déjà construite serait ruineux. Mais l’intégrer dans un plan de construction avant le démarrage des travaux est possible sans que le coût du chantier s’envole. Ne devrait-on pas y penser à chaque fois qu’un projet de construction implique de remuer de grandes quantités de terre.
À lire
La lutte pour contenir le réchauffement climatique nécessitera des moyens matériels, et les volontaires pour s’y atteler, et ceux ci ne manquent pas. Il faudra aussi des financements gigantesques, la plupart du temps sans espoir de gain. Peut on imaginer une humanité marchant à sa perte simplement par manque de monnaie ? Hélas, les banques centrales qui règnent sur la création de monnaie veillent avant tout sur la stabilité du système financier. Pourtant, la monnaie n’est qu’une convention : lire « Le pouvoir de la monnaie » par Jézabel Couppey Soubéran, Pierre Delandre et Augustin Sersiron.
Mars 2024
Pour cette deux cent deuxième réunion, une visite qui nous a fait plaisir et honneur : Karina Von Schuckmann nous a rejoints en vidéoconférence pour nous parler du déséquilibre énergétique de la Terre. Après des études à Kiel en Allemagne, elle a travaillé à l’IFREMER, puis rejoint Mercator-Océan où elle travaille actuellement. Elle y a été notamment chargée de piloter la rédaction des Rapports sur l’État de l’Océan produits pour le Service Copernicus de surveillance de l’environnement marin. Elle a reçu récemment le prix Gérard Mégie de l’Académie des Sciences.
Le déséquilibre énergétique de la Terre
La Terre reçoit de l’énergie du Soleil, principalement sous forme de lumière visible, et elle émet elle même un rayonnement infra-rouge vers l’espace. Sous un climat en équilibre, ces deux quantités d’énergie sont égales. Mais à cause principalement de l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le rayonnement émis est plus faible que le rayonnement reçu, et notre climat se réchauffe.
Ce déséquilibre énergétique de la Terre, souvent désigné par EEI (Earth Energy Imbalance) peut être estimé à partir de l’Espace grâce aux mesures directes du rayonnement solaire incident et réfléchi et du rayonnement infrarouge émis au sommet de l’atmosphère. De telles mesures sont réalisées depuis 2000 par les radiomètres du satellite CERES de la NASA. Un simple coup d’œil à une photo de la Terre vue depuis l’espace montre combien cette tâche est difficile : la Terre n’a rien d’une surface homogène, et selon la nature de sa surface, elle réfléchit plus ou moins le rayonnement solaire. Les nuages en particulier, très réfléchissants, apparaissent en blanc, et leur répartition change sans cesse.
On peut aussi l’estimer par modélisation, en décortiquant pour chaque élément de surface les très nombreux processus par lesquels s’effectue le transfert de l’énergie. Une autre approche consiste à faire l’inventaire des différents réservoirs de chaleur du système climatique (océans, qui emmagasinent plus de 90 % de la chaleur en excès, atmosphère, cryosphère, sols, chaleur utilisée pour évaporer l’eau ou fondre les glaces) et à suivre l’évolution de cet inventaire. Enfin, le suivi de la hausse du niveau marin, qu’on connaît avec précision grâce aux altimètres embarqués sur des satellites, apporte une forte contrainte pour ces estimations : cette hausse est due, d’une part à la fonte des calottes glaciaires, et d’autre part à la dilatation de l’eau de mer à cause de son réchauffement, que l’on observe correctement depuis l’an 2000 entre la surface et 2000 m de profondeur grâce au réseau de flotteurs ARGO (environ 4000 répartis dans l’océan mondial).
L’incertitude sur les estimations de l’EEI est très élevée, à cause de la variabilité des nuages, du manque de connaissances sur les aérosols qui réfléchissent (ou, pour certains, absorbent) le rayonnement solaire, et à cause de la difficulté d’estimer le contenu de chaleur et les flux de chaleur mis en jeu par les changements d’état de l’eau. De plus, ce déséquilibre n’est qu’une petite fraction des flux d’énergie incident ou sortant du système climatique : seulement 1 Wm-2 alors que le rayonnement solaire fournit à la Terre 340 Wm-2. Les études récentes montrent que l’EEI augmente lentement, probablement en réponse aux émissions de gaz à effet de serre, et surtout à l’accélération de ces émissions (Figure 1). Ce déséquilibre peut être interprété comme une mesure de la partie du forçage anthropique à laquelle la Terre n’a pas encore répondu : c’est la quantité la plus pertinente pour définir les perspectives de poursuite du changement climatique. La hausse de la température moyenne à la surface du globe est la donnée qui retient le plus notre attention, mais seule la connaissance des termes de ce déséquilibre a permis de comprendre pourquoi cette hausse de la température a marqué une pause vers 2010 (le «hiatus») et permettra de connaître les causes de la brusque augmentation de la température moyenne globale, toujours en cours, en mars 2023. Les progrès espérés pour mieux estimer l’EEI reposent surtout sur l’amélioration des systèmes d’observation : identifier et quantifier les aérosols, mieux observer les zones polaires (mal observées par les satellites à orbite inclinée) et les masses glaciaires, étendre les mesures de température de l’océan au-delà de 2000 m de profondeur.
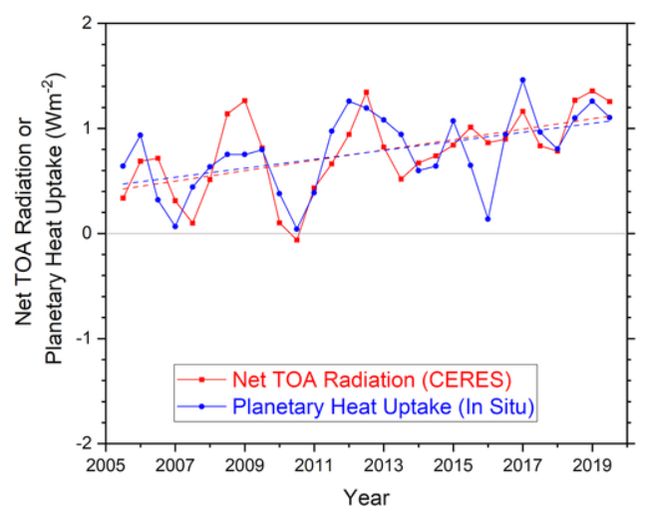
d’après Loeb et al., 2021
Figure 1 : évolution du déséquilibre énergétique de la Terre estimé par les mesures radiométriques du satellite CERES et par des inventaires des réservoirs de chaleur du système climatique.
Moins de neige, moins de glace, le niveau marin qui s’élève...
Le réchauffement du climat ne fait pas l’affaire des stations de sports d’hiver. Malgré un retour des précipitations cet hiver, elles ont souvent manqué de neige et ont du garnir leurs pistes de neige artificielle. Les dirigeants de ces stations s’organisent : ne pas trop en parler pour garder la confiance des amateurs de sports d’hiver. Dans certains cas, des solidarités se mettent en place, sous forme d’un partage des aléas financiers liés au climat : des stations pénalisées par une perte d’enneigement prononcée recevraient une aide de la part d’autres stations, plus chanceuses.
Chaque mois sortent des dizaines d’articles dans des revues scientifiques qui décrivent la perte de masse des calottes glaciaires et comment, au contact d’un océan qui s’élève et se réchauffe, l’écoulement des glaciers des zones polaires accélère. L’eau de mer, qui se réchauffe légèrement, fait fondre la glace et parvient à pénétrer sous les glaciers. Ceux ci, qui achevaient leur descente sur un socle rocheux, sont moins retenus par la friction sur le fond et avancent maintenant plus vite, faisant craindre une accélération de la hausse du niveau marin. La plupart de ces articles s’appuient sur des études locales, qui concernent quelques glaciers. Certains sont très alarmistes. Une vision d’ensemble manque encore.
La montée du niveau marin menace les zones en bord de côte, et notamment les zones construites et les villes. À quelle montée doit on s’attendre pour la fin du siècle ? 60 cm ? Aux Pays Bas, des digues peuvent résister à des hausses exceptionnelles de 5 mètres. Mais se barricader derrière des digues ne résout pas tous les problèmes. Au fur et à mesure que le niveau des mers s’élève, il devient de plus en plus difficile et coûteux d’évacuer les eaux de pluies en cas de très fortes précipitations. Que penser alors d’un projet que certains auraient en tête qui consisterait à dresser une gigantesque digue, d’une part entre la Bretagne et la Cornouaille, et d’autre part entre l’Écosse et le Danemark, afin d’arrêter la hausse du niveau marin en Manche et en Mer du Nord et ainsi protéger d’un seul coup (mais quel coup!) les villes et ports côtiers de la région ? Après quoi il faudra penser à évacuer les eaux apportées par le Rhin, la Seine et la Tamise, et autres fleuves côtiers de moindre débit.
La fonte des glaces ne fait pas qu’alimenter la montée du niveau marin, elle apporte aussi de l’eau douce dans les océans et les courants marins s’en trouvent modifiés. D’après une étude publiée tout récemment par le Copernicus Marine Service, la masse d’eau froide et peu salée au nord-est de l’Atlantique qui en résulte renforce le front qui sépare les eaux subpolaires des eaux subtropicales, et ce front tend à se renforcer et à remonter vers le nord. L’été suivant, il dévie les vents d’ouest de basse altitude vers le nord et une anomalie chaude accompagnée de sécheresse s’installe sur l’Europe : de meilleures prévisions à moyen terme ? À suivre...
Transition écologique : coups de frein
Pièce maîtresse de la transformation durable des entreprises en Europe, le projet de directive sur le devoir de vigilance, a été bloqué par 14 états membres de l’Europe. En réponse à la crise agricole qui a éclaté en France et dans d’autres pays, les politiques ont fait machine arrière sur des mesures en faveur de la transition écologique. Et ce ne sont pas les partis populistes en pleine ascension qui redresseront la barre. Faudra-t-il prochainement une série de catastrophes climatiques pour que les sociétés reprennent une route plus raisonnable pour restaurer la biodiversité et s’adapter au changement climatique ?
À quoi ressemblent les «rivières atmosphériques» ?
Un nouveau terme est apparu depuis quelques années dans les nouvelles qui concernent le climat, et en particulier les inondations : celui de «rivières atmosphérique». Invisibles, celles ci sont difficiles à imaginer. Le concept est pourtant simple : il s’agit de vents organisés en grands courants aériens, qui transportent beaucoup de vapeur d’eau. Une superbe rivière atmosphérique nous a amené des pluies abondantes en février dernier (figure 2). On peut les visualiser facilement sur des cartes de contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère sur ce site. Elles se manifestent par de longues branches, dans lesquelles les structures de grande échelle dominent, émises depuis la zone équatoriale très chargée en humidité.
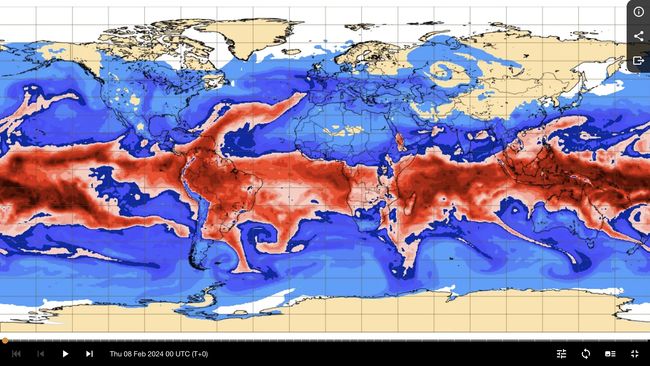
Figure 2 : contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère le 19 février 2024. Une une branche issue de l’Atlantique équatorial transporte de l’humidité jusqu’en Europe de l’ouest.
Monnaies virtuelles et consommation d’énergie
Les monnaies virtuelles donnent parfois l’impression qu’il ne s’agit que d’une toquade lorsque leur cours baisse, et font figure de solution d’avenir lorsqu’il remonte. En attendant, elles coûtent cher en énergie : le seul Bitcoin en consonne à peu près autant qu’un pays comme la Hollande! Le besoin d’énergie vient des calculs qui vérifient et valident la création des Bitcoins et les transactions réalisées avec eux. Ces calculs reposent sur des codes qui n’ont aucunement été conçus avec un souci d’économie d’énergie. Cette voracité énergétique peut pourtant sans doute être, sinon évitée, du moins ramenée à des valeurs plus raisonnables : l’Ethereum, une autre monnaie virtuelle, consomme proportionnellement dix fois moins d’énergie que son rival le Bitcoin.
Réparer le climat : de bonnes affaires en vue
Le XPRIZE Carbon Removal, soutenu par Elon Musk et sa fondation, destiné à soutenir des projets de capture du carbone atmosphérique, a attiré 1300 candidats, parmi lesquels 300 se disent déjà prêts à commencer dès 2024. À la clé, l’espoir d’engranger des crédits. Il est à craindre que des pays se laissent convaincre de l’efficacité de leurs propositions et les financent. Ce qui s’est passé au cours de la dernière décennie n’encourage pas à la confiance. Les plantations de forêts réalisées par des sociétés pour compenser des émissions de carbone fossile ont trop souvent été conduites dans de très mauvaises conditions. Beaucoup des méthodes proposées soulèvent de fortes réserves de la part des scientifiques, et la vigilance s’impose.
Le Time magazine a ainsi décerné le titre de «meilleure invention en 2023 dans la catégorie soutenabilité» à un projet consistant à précipiter les ions bicarbonate de l’eau de mer sous forme de calcaire, par stimulation électrique. Le calcaire ainsi formé est retiré du milieu réactif océan–atmosphère, et constituerait donc un puits de carbone. Ceci n’est pas nouveau. C’est la technique utilisée pour fabriquer du récif artificiel. Le problème est que cela retire bien des ions bicarbonate de l’eau de mer, mais ne favorise pas l’absorption de gaz carbonique par l’océan. Au contraire, comme c’est le cas pour la fabrication de coquilles par les mollusques marins, ou de pièces calcaires par les coccolithophoridésdes, ce processus s’accompagne d’une augmentation de la concentration en gaz carbonique de l’eau de mer. La pression partielle de ce gaz dans l’eau devenant alors supérieure à celle dans l’atmosphère, la mer devient émettrice de gaz carbonique : un résultat contraire à celui promis.
Réchauffement des océans : où en sommes nous ?
Le réchauffement est général ; presque partout, la température de surface des océans est plus chaude que la moyenne des 30 dernières années, et elle est particulièrement marquée dans l’Atlantique tropical (figure 3) où la zone de record de hausse absolu rejoint les côtes de l’Europe de l’ouest, et englobe la Méditerranée. Remarque : la rivière atmosphérique entre l’Amérique centrale et l’Europe (figure 2) qui nous a amené beaucoup de pluie en février s’appuie sur la ligne sud ouest–nord est qui sépare les eaux qui montrent un réchauffement record de celles, au nord ouest, qui se sont peu réchauffées, voire même refroidies.
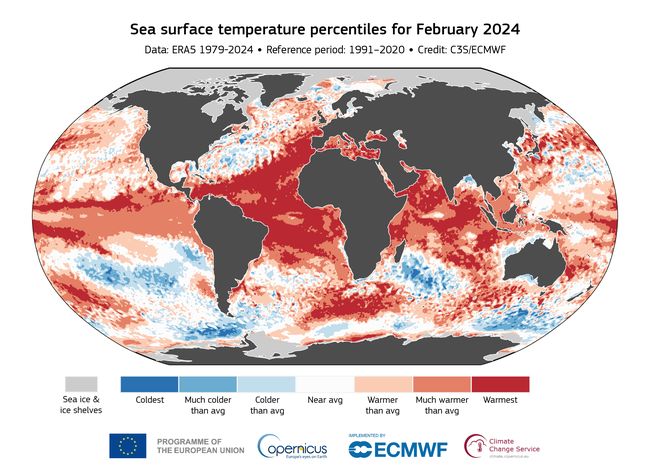
Figure 3 : réchauffement de la température de surface des océans en février 2024.
Des ballons sonde pour étudier l’atmosphère : souvenirs...
L’annonce d’essais de ballons instrumentés par le CNES en vue d’une prochaine campagne de mesures atmosphériques a fait ressurgir chez nombre d’Argonautes l'époque où ils faisaient leurs débuts dans la recherche. L’expérience spatiale Éole, en référence au dieu du vent, de 1962 à 1972, a en effet constitué une vaste aventure pour les chercheurs français qui étudiaient la dynamique de l’atmosphère, et collaboration avec les États Unis. Il y avait au cœur du projet 500 ballons destinés à être lâchés dans l’atmosphère et a être suivis par un satellite de collecte de données et de localisation. L’ensemble devait fournir une représentation de la circulation atmosphérique à une époque, peu après l’Année Internationale de Géodésie Géophysique, où celle ci était encore très mal connue. Le projet était très ambitieux pour l’époque, et devait affronter des difficultés nouvelles. La localisation continuelle d’un aussi grand nombre de ballons était un challenge, confié à un satellite dédié. Optimiser leur durée de vie a conduit à les placer à 12000 mètres d’altitude. Et, difficulté qui n’avait rien de scientifique, mais qui n’était pas moins très réelle, il y avait un risque de collision avec le trafic aérien. Pour minimiser ce risque, le poids de l’électronique attachée aux ballons a été réduit autant qu’il était possible, soit 5 kg, l’hémisphère nord a été fermée au projet car l’essentiel du trafic aérien y avait lieu, et les ballons ont été dotés d’une charge explosive déclenchable à distance au cas où des ballons se seraient aventurés dans l’hémisphère nord. Aucun ballon ne s’y est aventuré, mais une erreur de commande a conduit à détruire une centaine des ballons sur les 480 qui ont été lancés. Cet épisode est souvent rappelé dès qu’on évoque l’expérience Éole, mais heureusement, les résultats scientifiques ont été remarquables.
Les déploiements ont été effectués le long d’un méridien en Argentine en 1971, grâce entre autres à deux Argonautes. Et nous apprenons au cours de cette 202ème réunion que quelques uns des tubes de 5 kg qui renfermaient l’électronique des ballons Éole ont été récupérés par des hydrologues au Congo pour une première expérience de télétransmission vers Toulouse des données d’observations pluviographiques avec retour par telex, suivie d’une autre en Guyane pour des données limnigraphiques : encore des succès d’Éole !
Quelques expériences basées sur des ballons ont suivi Éole, et quelques unes sont encore en projet, mais de bien moins grande ampleur. Les satellites instrumentés ont pris le relais. L’un des plus récemment lancés, à la fin de 2022, SWOT (Soil Water and Ocean Topography) donne ses premiers résultats, très prometteurs. L’avenir français et européen est toutefois entravé par le retard de la préparation de la fusée Ariane 6, alors qu’on a clos prématurément la fabrication d’Ariane 5. L’espace invite toujours à l’aventure : ne voilà-t-il pas qu’un astéroïde, nommé Apophis, se dirige vers la Terre, qu’il va « frôler » à 30 000 km. Dévier un astéroïde de sa trajectoire est un bon sujet de film de science fiction.
Février 2024
L’eau et le changement climatique
Pendant cette 201ème réunion du Club des Argonautes, nous avons beaucoup parlé d’eau, de pluies, et de ressources en eau. Avec le réchauffement climatique en effet, un degré supplémentaire pour la température implique que l’atmosphère peut théoriquement contenir 7 % de vapeur d’eau en plus. Or, nous approchons du seuil de + 1,5 °C adopté lors de l’Accord de Paris. Mais ceci ne signifie pas que les pluies vont augmenter autant que la capacité de l’atmosphère à contenir de la vapeur d’eau. L’augmentation des pluies est estimée à seulement 2 % par degré de réchauffement. Le changement climatique devrait à la fois intensifier les pluies extrêmes et les inondations, et aggraver les sécheresses. Sur les continents, le cycle de l’eau est très fortement dépendant de caractéristiques locales : selon l’état du sol, une part plus ou moins grande s’infiltrera, ruissellera vers les rivières, ou alimentera les nappes phréatiques. Une partie sera reprise par l’évaporation, et tout spécialement par l’évapotranspiration du couvert végétal, puis recyclée. Un risque d’inondation plus ou moins grand ? Des épisodes de sécheresse plus longs ? La réponse dépend de la circulation atmosphérique, de la température de l’air, de l’état des sols et des cultures, et est donc régionale plutôt que globale.
Les conditions climatiques sont très variables d’une région à une autre, ou d’une saison à une autre. Ainsi, ces dernières années, la Californie a alterné des périodes de sécheresse intense avec des incendies ravageurs, et aussi des inondations à la suite de pluies torrentielles. En France, la sécheresse très marquée de début 2023 a été interrompue par un retour des pluies, et les nappes phréatiques, surveillées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), ont retrouvé un niveau normal. Ce n’est toutefois pas le cas dans le pourtour méditerranéen, et en particulier, dans le Roussillon où les nappes phréatiques sont restées basses, ce qui peut remettre en question les choix agricoles de cette région. La politique touristique aussi devra être revue : il y a très peu de neige sur les Pyrénées et le peu qui est tombé a fondu à cause de températures anormalement élevées. Cette sécheresse se prolonge en Catalogne espagnole où il faudra acheminer de l’eau, ce qui s’est fait par le passé, en 2008, par tanker. Un approvisionnement par canal depuis le Rhône avait alors été étudié (projet Aquadomitia) mais s’était heurté à la difficulté de franchir les Pyrénées, et aussi à la réticence des agriculteurs français concernés.
Des solutions pour faire face à d’éventuels manques d’eau
On s’équipe de plus en plus en réservoirs destinés à recueillir l’eau de pluie, en général pour des usages autres que l’eau potable : arrosage du jardin, chasse d’eau, lavage. Recueillie dans une région à l’abri des pollutions atmosphériques, d’origine agricole ou industrielle, l’eau de pluie est potable, mais lors de sa conservation, ou de son passage dans des tuyauteries, elle risque d’être contaminée. Les navires modernes disposent maintenant de systèmes de désalinisation de l’eau de mer, mais les anciens marins (et même les vieux océanographes) connaissaient bien cette difficulté. Si, dans une maison, le circuit d’eau potable distribuée par les services publics et le circuit d’eau de pluie récupérée ne sont pas strictement séparés, il y a risque de contamination de l’eau publique. C’est pourquoi il y a une réticence de la part des services publics à autoriser l’usage de l’eau de pluie. Face à une éventuelle pénurie d’eau et à la disponibilité d’eau de récupération, la logique serait de récupérer les eaux de pluie, ou les eaux usées, puis de les traiter pour les rendre potables ou, à condition d’avoir installé un double réseau d’utilisation, les réserver à d’autres usages. Cette réutilisation et double réseau de distribution se pratiquent de plus en plus, mais la France est moins avancée dans ce domaine que l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Italie ou l’Espagne.
Le risque de pénurie d’eau douce pousse à rechercher des aquifères jusque sous la mer : de tels aquifères existent, et se manifestent parfois par des sources d’eau douce sur les fonds marins. Avant d’utiliser ces réserves, il faut les étudier et s’assurer que leur exploitation ne va pas avoir pour conséquence un déplacement du « biseau salé » entre l’eau douce et l’eau salée, et une salinisation de la ressource.
La fonte des glaciers menace-t-elle l’approvisionnement en eau douce de certains pays, notamment au pied de l’Himalaya, ou des Andes ? On a pu entendre que l’Himalaya était le château d’eau d’un tiers de l’humanité, et ce tiers serait à terme privé d’eau douce du fait de cette fonte. Heureusement, cette crainte n’est pas fondée : même si les glaciers fondaient totalement, les moussons et autres apports d’eau en provenance des océans continueraient. Mais il en serait fini de cette ressource d’eau de fonte au printemps, avant l’arrivée de la mousson, au moment où la végétation a le plus besoin d’eau et où les précipitations sont faibles. Il y aurait de nouvelles saisonnalités des ressources en eau auxquelles il faudrait s’adapter. Le cas de la ville de Lima au Pérou et de ses dix millions d’habitants est particulier : sur ce versant ouest des Andes, il ne tombe que 50 mm d’eau par an et les glaciers qui fournissent l’eau sont alimentés par des précipitations qui viennent principalement de l’est, en provenance de l’Atlantique. A contrario le versant amazonien est très bien arrosé et une solution techniquement envisageable, mais très onéreuse, pourrait être d’opérer des transferts vers le versant pacifique.
Changement climatique : comment faire machine arrière ?
À un rythme qui s’est accru depuis le début de l’ère industrielle et qui, avec l’urgence de lutter contre le changement climatique, commence à peine à se ralentir autour de 37 milliards de tonnes par an, nos émissions de gaz carbonique ont ajouté à l’atmosphère plus de 900 milliards de tonnes de ce gaz à effet de serre. Le gaz carbonique est chimiquement très stable, et il n’est pas envisageable de lui retirer chimiquement ce rôle climatique, sauf à utiliser une énergie considérable, au moins égale à celle que nous a fourni le carbone fossile en brûlant. Bien sûr, il y a aussi les puits naturels, que sont la végétation terrestre et les océans, que l’on peut accompagner et aider, mais cela ne suffira pas. Il faudra de très gros moyens pour retirer ce gaz carbonique en excès dans l’atmosphère, et les compagnies pétrolières sont bien placées pour cela. Elles ont en plus la technologie et les gisements d’hydrocarbures épuisés où elles peuvent enfouir beaucoup de gaz carbonique. L’un des Argonautes a pu assister à un séminaire où une représentante de l’Agence Internationale de l’Energie a présenté un projet visant à enfouir 6 milliards de tonnes de gaz carbonique par an dans des gisements de pétrole épuisés (pourquoi ce chiffre ? On le trouve paraît-il dans certains scenarios du dernier rapport du GIEC.
Très bien : tout enfouissement de gaz carbonique est bon à prendre. Mais qui paiera ? Pour des quantités aussi importantes, on aimerait que l’initiative ne relève pas d’une aubaine financière et soit contrôlée par les états, afin d’éviter des dérives telles que les fraudes sur le marché des crédits carbone, ou les plantations de forêts censées piéger du gaz carbonique, mais totalement inefficaces faute de réelle volonté. Peut on faire confiance à des compagnies pétrolières dont l’enrichissement a perturbé le climat et qui s’enrichiraient encore en en corrigeant les effets ? Laisser faire le marché paraît dangereux alors qu’on a besoin d’actions bien conduites et coordonnées si on ne veut pas aggraver la crise climatique. Que les états prennent la direction de ces actions, et créent si besoin la monnaie nécessaire.
Du côté de l’intelligence artificielle, toujours du nouveau
La prévision météorologique par intelligence artificielle agite beaucoup Météo France, ainsi que la plupart des services chargés des prévisions dans les autres pays. L’intelligence artificielle est attractive en raison de la rapidité du calcul, et elle a montré qu’elle pouvait fournir d’excellentes prévisions. Les séminaires à ce propos se multiplient, auxquels des Argonautes ont pu assister. Les prévisions par modèles physiques et celles par intelligence artificielle ne s’excluent pas l’une l’autre : les modèles physiques de prévision météorologique peuvent incorporer des modules d’intelligence artificielle pour certains processus, et des contraintes physiques peuvent être imposées à l’intelligence artificielle. Un problème se pose : il faut entraîner l’intelligence artificielle sur des données. Il y a pour cela les «réanalyses» qui sont une représentation de l’évolution du climat basée sur les sorties des modèles rappelées à la réalité par les observations météorologiques. La réanalyse ERA 5 couvre les 40 dernières années. Mais au cours de ces 40 ans, le climat a évolué. Peut on baser des prévisions météo sur des données qui ne seraient plus de mise ? Il faudra trouver un compromis entre un apprentissage de l’intelligence artificielle sur une longue durée, gage de statistiques plus étendues, ou sur une durée plus courte, gage d’une meilleure adaptation à l’actualité.
Incontestablement, l’intelligence artificielle permet de gagner du temps de calcul. Faut il en attendre des progrès dans les prévisions ? On n’ira pas de toute façon jusqu’à prévoir le temps au-delà d’une certaine durée, qui dépend des caractéristiques climatiques locales. Au cours de cette durée en effet, des modifications mineures peuvent naître, se développer, devenir dominantes et orienter l’évolution du temps dans une direction autre.
Tenter de prévoir l’imprédictible, et alerter
Si la prévision des séismes demeure extrêmement difficile, celle des éruptions volcaniques progresse : elle se base sur l’observation des ondes sismiques, et sur les déformations de la surface du sol dans la zone du volcan. Il reste alors à prévenir la population locale et à en préparer l’évacuation, ce qui peut poser des difficultés, d’une autre nature. Ainsi, lors d’une éruption du volcan Mérapi en 2010 en Indonésie, pour alerter avec plus d’efficacité, il a été demandé à un chamane de lancer l’ordre d’évacuation. 350 000 personnes ont suivi cet ordre et ont ainsi échappé au danger. Les seules victimes ont été 353 habitants d’un village isolé qui n’ont pas pu être prévenues à temps, et le chamane lui même, qui, se considérant comme le gardien de la montagne, est resté sur place.
Ce recours à des instances «non scientifiques» se pratique aussi dans certains cas pour des catastrophes météorologiques. Ainsi, au Bangladesh, des alertes pour les crues du Bramapoutre ont été relayées par les mosquées.
L’association Christian Le Provost Océanographe prend le large
Christian Le Provost a apporté à l’océanographie une contribution déterminante, en développant un modèle de marée qui a permis l’estimation des courants marins par altimétrie satellitaire. Rappelons l’enjeu : de la même façon qu’on calcule les vents en utilisant les gradients de pression atmosphérique, il est théoriquement possible de calculer les courants marins à partir des variations du niveau marin. On était techniquement capables au début des années 90 de mesurer ces variations avec une précision suffisante. La principale difficulté venait de ce que les variations du niveau marin recherchées sont de l’ordre de quelques centimètres de hauteur, alors que partout dans l’océan les mouvements de marée induisent des mouvements quotidiens de plusieurs dizaines de centimètres. Pour calculer les courants, il fallait donc retirer l’influence des marées, et pour cela, les connaître. C’est ce qui a été rendu possible par le modèle de marées développé principalement par Christian Le Provost. Sa mort en 2004 a affecté tous ses collègues, parmi lesquels plusieurs faisaient partie du Club des Argonautes. Une association «Christian Le Provost Océanographe» a été fondée, qui depuis organise à intervalles réguliers des journées pour la diffusion des connaissances océanographiques à Saint Brieuc. Le Club des Argonautes a contribué à cette fondation et en a hébergé le site internet. Depuis 2008, l’Académie des Sciences a lancé le Grand Prix Christian Le Provost qui récompense tous les deux ans un jeune chercheur pour ses travaux en océanographie. Et depuis 2023, l’association «Christian Le Provost Océanographe» dispose de son propre site internet: https://christianleprovostoceanographe.fr . Bon vent !
- Écrit par : Yves Dandonneau
- Catégorie : Blog
Janvier 2024
Deux centième réunion, en distanciel hélas, du Club des Argonautes, créé en 2003 : faire sauter un bouchon tous ensemble sera pour une autre fois.
Et aussi première réunion de 2024 : parmi les cartes de voeux échangées pour le nouvel an, ce graphique où on voit s’envoler la courbe de la température moyenne à la surface de la Terre. Angoisse...
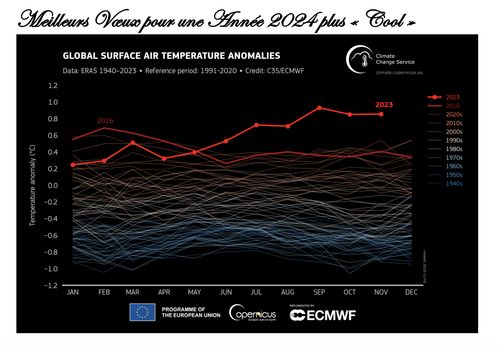
Transition écologique : des grincements
La forte priorité accordée par le gouvernement à la transition écologique a été très bien reçue par la majorité des scientifiques, qui s’y sont immédiatement engagés. Certains sont des Argonautes. Nous avons suivi avec intérêt ces derniers mois l’élaboration du projet de la formation des fonctionnaires à la transition écologique. Après les rapports successifs du GIEC et la prise de conscience des conséquences du changement climatique, l’heure est maintenant à la prise de décisions pour s’y adapter, ou en réduire l’intensité. Et ces décisions sont à prendre région par région, en fonction de leurs différences géographiques et de leurs activités dominantes. Et c’est là que surgissent des difficultés multiples, du fait d’intérêts contradictoires, et de la crainte des politiques de voir se développer d’amples conflits. Ainsi, le Haut Conseil Breton pour le Climat piétine, et le RECO (Réseau d’Expertise sur les Changements Climatiques en Occitanie) s’est heurté à des difficultés et est contraint d’abandonner une partie des activités qui faisait de lui un outil régional pour la transition écologique .
Les grandes idées pour la transition ne manquent pas, mais leur mise en application se heurte bien souvent aux réticences et contradictions de nos sociétés ; le chemin pour y conduire est plus confus et se défriche – ou ne se défriche pas – parmi les conflits et les intérêts particuliers, et en découvrant des difficultés inattendues au fur à mesure qu’on avance. On peut citer par exemple ce conflit entre la vision des Bâtiments de France et la nécessité d’isoler thermiquement les habitations : les maisons à colombages d’Alsace ne peuvent pas être isolées par l’extérieur (sauf à abîmer l’attrait touristique) ni par l’intérieur car les poutres deviennent alors humides et pourrissent. Heureusement, il y a parfois des progrès encourageants : par exemple, les forêts françaises, gérées en très grande majorité par des propriétaires privés, échappaient très largement à tout contrôle, ces propriétaires négligeant de rendre compte de leur gestion. Désormais, ils devront tenir à disposition un «plan simple de gestion» de leurs parcelles, sans lequel leur activité échappait complètement au contrôle public. La transition écologique s’ouvre sur une multitude de petites négociations.
La végétation terrestre, puits de carbone en déclin
Les sécheresses liées au changement climatique et les épisodes caniculaires, altèrent la santé des forêts. Les insectes parasites des arbres (les scolytes, redoutés dans les forêts de résineux) et les incendies prolifèrent sur les forêts les plus atteintes. Dès qu’on s’est intéressé au cycle du carbone dans le contexte du changement climatique, la végétation terrestre (ainsi que les océans) est vite apparue comme un puits pour le gaz carbonique émis lorsque nous brûlons des hydrocarbures ou du charbon. En effet, toutes conditions égales par ailleurs, la croissance des végétaux est stimulée dans une atmosphère plus riche en gaz carbonique. Mais la hausse des températures place souvent les écosystèmes existants à la limite de leur résistance. Des forêts affaiblies se défendent moins bien contre les parasites, et les incendies s’y propagent plus facilement. D’autre part, sous un climat plus chaud, les processus de dégradation de la matière organique (respiration, action des bactéries) est accélérée, et la durée de vie du carbone organique (c’est à dire le temps moyen entre la photosynthèse des produits végétaux et leur retour à la forme gaz carbonique) raccourcit : le stock de carbone organique diminue donc. C’est ce qu’a analysé Philippe Ciais au cours d'une conférence organisée par le Bureau des Longitudes (à paraître prochainement). Ce déclin du puits de carbone demande à être analysé plus profondément. Les études du couvert végétal de la Terre, morcelé entre sols et pratiques culturales hétérogènes, vont bénéficier d’un nouvel outil satellitaire d’observation, avec une définition spectrale plus fine et une résolution au sol de 3 mètres. La richesse d’informations qui en résultera devra être traduite en quantités géochimiques : un chantier immense est ouvert.
Le réchauffement s’arrêtera-t-il dès qu’on n’émettra plus de gaz carbonique ?
Sous cette question s’en cache une autre : les puits naturels de gaz carbonique continueront-ils de fonctionner si nos émissions cessent ? Le puits dans la végétation des terres émergées, on l’a vu précédemment, montre des signes d’affaiblissement. La forêt amazonienne, parfois désignée comme le «poumon de la Terre», émet maintenant davantage de gaz carbonique que sa photosynthèse n’en absorbe. L’autre puits naturel, dans les océans, devrait continuer à fonctionner pendant longtemps. Si la couche superficielle (les 100 premiers mètres environ) atteint l’équilibre en gaz carbonique avec l’atmosphère en un an environ, cet équilibre est sans cesse remis en question par le mélange avec l’eau profonde dont les carbonates tiennent leurs caractéristiques d‘un équilibre pré-industriel avec l’atmosphère. Le mélange de cette eau profonde avec l’eau de surface est très lent, de sorte que le puits océanique de gaz carbonique devrait persister pendant environ mille ans tout en s’atténuant progressivement.
Économie et lutte contre le changement climatique
Tous les projets de lutte contre le changement climatique ou d’adaptation à ses conséquences demandent des financements très importants, et force est de constater que ceux qui maîtrisent les plus gros flux financiers ne sont pas ceux qui montrent le plus fort engagement en faveur de ces projets. Ne faudrait il pas créer de la monnaie spécifiquement dans ce but ? Or, actuellement cette création se fait sans préoccupation de la transition écologique. La création monétaire est un bien public, et ce bien public a hélas été privatisé. Des ouvrages spécialisés traitant de cette anomalie ont été rédigés, et même, plus récemment, des romans destinés à un large public.
Le changement climatique fait la une de l’actualité
2023 a été, et de loin, l’année la plus chaude depuis que les réseaux d’observations météorologiques existent. Les principales agences, Copernicus, la NOAA, la NASA, le WMO font très rapidement et très bien les bilans climatiques de l’an passé. Le graphique ci-dessous qui décrit le réchauffement observé depuis 1880 en fonction de la latitude est intéressant à double titre : d’une part il montre que ce réchauffement est plus intense vers les pôles qu’à l’équateur, et d’autre part, qu’il est beaucoup plus marqué dans l’hémisphère nord où se trouvent la majorité des masses continentales, que dans l’hémisphère sud, très maritime. Les océans en effet emmagasinent en profondeur l’excès de chaleur dû à l’augmentation de l’effet de serre, de telle sorte que le réchauffement est moins marqué en surface.
L’océan, propice aux fantasmes ?
Perdons nous la raison lorsque nous parlons des océans ? Cela semble bien parfois être le cas. Ainsi, on entend souvent dire dans les médias (et, hélas, dans certains milieux scientifiques) que l’océan fournit la moitié de l’oxygène que nous respirons. Avec la conséquence angoissante que si les écosystèmes océaniques venaient à dysfonctionner, nous pourrions manquer d’oxygène ! C’est faux. Il est vrai que l’oxygène présent dans l’atmosphère (dont il constitue un cinquième, soit 200 000 parties par million) s’y est accumulé lorsque l’apparition de la photosynthèse a permis le développement de la vie sur Terre. Mais depuis cette «grande oxydation», l’oxygène produit par photosynthèse est rapidement et quasi intégralement utilisé par la respiration de la macro et de la microfaune. Il en va ainsi dans les océans où la photosynthèse produit de l’oxygène en quantité exactement indispensable pour la respiration du zooplancton et des bactéries qui se nourrissent de la biomasse végétale ainsi produite, ainsi que pour l’oxydation des débris organiques. Les océans ne nous fournissent donc pas 50 % de l’oxygène que nous espirons, mais 0 %. D’où vient cette croyance ? Il est indubitable que les 200 000 parties par million d’oxygène que contient l’atmosphère viennent de la photosynthèse ancienne. On estime aussi que la photosynthèse actuelle se partage à égalité entre l’océan et la végétation terrestre, mais là, il n’est question que de deux ou trois parties par million, très loin donc de 200 000. Hélas, la croyance est tenace, et il est probable que certains professeurs de SVT l’enseignent à leurs élèves.
Autre domaine où on perd la raison : capter l'énergie de la houle. Le spectacle des vagues qui se brisent sur les rochers ou sur les digues évoque une réserve d’énergie énorme. Ne devrions nous pas la capter ? Les inventeurs qui se sont penchés sur le problème ne manquent pas, et les projets les plus farfelus ont été élaborés, et parfois déployés en mer. Il y a des dispositifs qui ont fonctionné, de petite taille, comme par exemple sur des bouées pour charger une batterie qui alimente le fanal d’une bouée en mer. Ces dispositifs sont d’ailleurs maintenant remplacés par des panneaux solaires. Pour des projets plus ambitieux hélas, l’énergie de la houle varie comme le carré de sa hauteur, et un dispositif conçu pour la capter dans des conditions normales sera soumis à des forces trop intenses et sera détruit en cas de tempête, tandis qu’un dispositif conçu pour des mers très fortes restera inopérant la plupart du temps. Par exemple, le projet Pelamis, constitué d’une ligne de flotteurs articulés mis en mouvement par la houle, a approximativement la taille d’une rame de TGV : pour qu’il résiste à une forte tempête, ses points d’ancrage devraient être ultra résistants, et extrêmement coûteux ! Pourtant, de temps à autre, ces projets refont surface, inchangés, dans les médias, à la faveur de quelque forum international sur les océans.
Parmi les vagues géantes qui font rêver les amateurs de surf, les «vagues scélérates» redoutables, imprévisibles et gigantesques sont remarquables. Le site web des Argonautes comporte une page sur les vagues scélérates qui est l’une de nos pages les plus visitées et qui vient d’être remise à jour : n’hésitez pas à la consulter, les accidents rapportés sont étonnants !
Mare incognita
Dans les années 60, les langoustiers recherchaient au sextant et aux étoiles le mont sous marin Vema, culminant à 40 m de profondeur, loin à l’ouest de l’Afrique du sud. Quand ils le trouvaient, c’était la certitude d’une pêche miraculeuse : il y avait tellement de langoustes que celles qui ne pouvaient pas entrer dans les casiers s’accrochaient à l’extérieur. Depuis, grâce aux satellites munis d’altimètres, on a pu découvrir et localiser 19 000 monts sous marins (tous ne grouillent évidemment pas de langoustes). L’orbite suivie par les satellites en effet n’est pas une trajectoire elliptique parfaite, mais est affectée par toutes les anomalies de gravité du globe terrestre, dues à la répartition locale de masses telles que, en particulier, ces monts sous-marins. Un des objectifs de l’altimétrie satellitaire est d’estimer les courants marins à partir des irrégularités du niveau de l’océan (quelques cm) qu’ils induisent. Il faut pour cela connaître avec précision et dans tous ses détails le géoïde terrestre, et donc, en particulier, tous les monts sous marins. En reste-t-il encore que nous ne connaissons pas ? Oui, très probablement, et le nouvel altimètre du satellite SWOT, lancé en décembre 2022, et dont les premiers résultats s’avèrent excellents, permettra certainement d’en découvrir de nouveau.
Les jours se suivent, plus ou moins…
Les océans sont sujets à des marées, et on sait que celles ci sont causées par les effets d’attraction du Soleil et de la Lune. Ces mouvements ont un coût, que la Lune paie en s’éloignant de la Terre de 3,8 cm par an, et que la Terre paie en tournant sur elle même de moins en moins vite.
Pourtant, au contraire, depuis 2016, elle s’est accélérée, au point qu’on parle de retirer dans l’échelle du temps une seconde supplémentaire. La vitesse de rotation de la Terre est en effet affectée par d’autres facteurs, comme des déplacements de masses dans le manteau terrestre, très mal connus. Un calcul rapide montre que la fonte des masses glaciaires situées en altitude près des tropiques et de l'équateur peut expliquer une bonne part de l'accélération de la rotation de la Terre de ces dernières années. A des échelles de temps plus courtes, les déplacements de masses d'eau et le ralentissement des vents alizés dus à El Niño ont aussi une influence sur cette vitesse.. Ces découvertes ont été permises par des mesures de plus en plus précises. George Darwin (le fils de Charles Darwin) a réalisé des travaux qui ont été fondateurs dans ces domaines. Et plus récemment, c’est le modèle numérique de marées mis au point par Christian Le Provost qui a permis d’affiner ces connaissances.
Le Club des Argonautes s’est mobilisé pour que soient organisées à Saint Brieuc chaque année des journées scientifiques en la mémoire de ce collègue et ami, décédé en 2004. Le prix «Christian Le Provost» est maintenant l’un des prix de l’Académie des sciences, et est décerné tous les deux ans à un jeune chercheur océanographe, physicien ou biogéochimiste. Il a été attribué cette année à Damien Desbruyères pour ses travaux sur les transports de chaleur par l’Océan Atlantique entre les régions équatoriales et l’Arctique. Ce prix lui sera décerné aux journées de Saint Brieuc le 19 avril prochain.
Rêves et écrits sur le futur : nous avons lu
Le ministère du futur par Kim Stanley Robinson, Bragelonne, 552 p., 2023
https://www.bragelonne.fr/catalogue/9791028120863-le-ministere-du-futur/
Ce passionnant roman de science fiction, certainement nourri d’une très vaste documentation, nous conduit d’une Terre au bord du désastre climatique au milieu du XXIème siècle, à l’amorce une situation apaisée et durable. Les solutions et les crises traversées pour y parvenir incluent la création d’une agence dédiée de l’ONU, la généralisation de pratiques non polluantes, des opérations de géo-ingénierie, une révolution monétaire, et même des actions terroristes.
- Détails
- Écrit par : Yves Dandonneau
- Catégorie : Blog
Lire la suite : Propos sur le climat et ses composantes, au Club des Argonautes
C’est fini pour CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation)
Danièle Hauser septembre 2023.
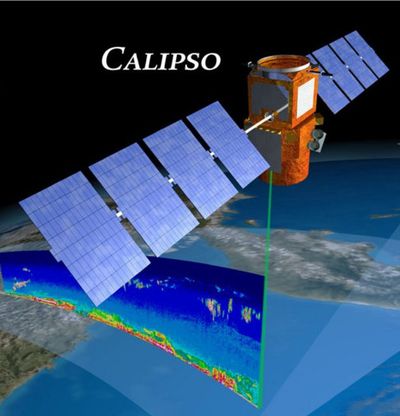
Source NASA
Après 17 ans de mesures en continu, la mission scientifique spatiale CALIPSO (NASA, CNES) a pris fin le 1er août 2023 (Calipso tire sa révérence, CNES - Official end of Calipso science mission, NASA). Ce satellite faisait partie depuis 2006, d’une «constellation» dénommée «A-Train» comprenant, dans le cadre d’une coopération américano-franco-japonaise, les satellites Aqua, Parasol, Cloudsat, Aura, puis GCOM-W1 et OCO-2. La particularité de cette constellation est d’avoir choisi une orbite commune à tous ces satellites, ce qui permet d’obtenir des observations colocalisées et quasiment simultanées sur les nuages, les aérosols, la chimie atmosphérique et d’autres éléments intervenant sur le cycle de l’eau et le bilan radiatif de la terre.
- Détails
- Écrit par : Danièle Hauser
- Catégorie : Blog
Coup de chaud sur l’été boréal de 2023
Yves Dandonneau Août 2023
L’été 2023 de l’hémisphère nord semble marquer un saut brutal dans l’évolution du climat, tant les canicules et incendies y ont été nombreux et intenses. Si certains événements récents ont pu contribuer à cette situation qui nous paraît extrême, le réchauffement climatique et la variabilité interannuelle du climat suffisent à expliquer ce brusque réchauffement qui nous annonce dans quel monde nous vivrons dans quelques années.
Après la crainte en France que la sécheresse de l’hiver 2022-2023 se poursuive durant tout l’été et conduise à de graves pénuries d’eau, les catastrophes climatiques et les records de température se sont multipliés dans le monde au mois de juin et de juillet :
- canicule en Europe du sud et de l’est,
- inondations en Inde au Pakistan et à Pékin,
- pluies torrentielles au nord-est des États Unis et températures record au sud-ouest,
- chaleur extrême et sécheresse en Uruguay, en Chine continentale, en Afrique du nord et au Moyen-Orient,
- gigantesques feux de forêt au Canada,
- inondations en Corée, en Chine, au Japon et aux Philippines.
Moins sensible pour nous mais non moins alarmant, la température moyenne à la surface des océans a augmenté rapidement depuis le début de 2023 et atteint elle aussi des niveaux record, notamment dans l’Atlantique nord. Une telle avalanche de conditions extrêmes signifie-t-elle que le climat s’emballe et échappe aux prévisions, ou bien tout cela est il explicable et conforme aux connaissances actuelles ?
- Détails
- Écrit par : Yves Dandonneau
- Catégorie parente: Blog
- Catégorie : Climat
Sixième rapport du GIEC: publication du groupe III - Comment répondre au changement climatique ?
Raymond Zaharia
En 2007, le 4ème rapport du GT I du GIEC, (sur les bases scientifiques de l'étude de la perturbation en cours du climat), démontrait que les émissions anthropiques dans l’atmosphère (gaz carbonique & autres gaz à effet de serre), étaient bien la cause d’un réchauffement du climat.
Les cinquième (2014) et sixième (2021) rapports de ce groupe ne font que confirmer et préciser les détails du changement climatique en cours, et d’en affiner les prévisions, régionalement et selon nos comportements futurs.
Conformément à ces avertissements répétés, un grand nombre de pays ont ratifié en 2016 l’accord de Paris, dans lequel ils s’engagent à faire en sorte que la température de surface en moyenne globale (la TSMG... dans la suite), ne dépasse pas de plus de 2°C, voire même de plus de 1,5°C, ce qu’elle était avant l’ère industrielle.
Depuis 2018, le GIEC a publié divers rapports, notamment celui montrant les différences entre un monde à + 1,5°C, et un monde à + 2°C. Tandis que le premier n'est pas très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, le monde à + 2°C est un monde dans lequel de vastes régions du globe sont devenues inhabitables, en raison notamment de submersions littorales, d’inondations ou de sécheresses prolongées, ou en raison d'une chaleur humide en zone tropicale incompatible avec la santé des habitants :
"Chaque dixième de degré compte" selon Valérie Masson Delmotte, Co-Présidente du GT I.
Malgré ces avertissements, nos émissions dues aux combustibles fossiles se poursuivent, à un rythme élevé, et si elles tendent à se stabiliser depuis 2015 aux environs de 35 GtCO2, (c. à d. 35 milliards de tonnes de CO2) par an, une décroissance ne s’est pas amorcée en dépit de la crise due à la pandémie de COVID 19.
Pourtant, les nombreux articles scientifiques revus et validés par leurs reviewers avant publication obéissent aux lois de la physique: tout esprit rationnel ne peut douter de la réalité des processus décrits et de leurs conséquences, que les observations récentes ne cessent de confirmer.
En plus de ce premier groupe de travail dédié aux aspects scientifiques du changement climatique, le GIEC comprend deux autres groupes qui se concentrent sur les aspects économiques:
l’un consacré aux impacts, à la vulnérabilité et à l’adaptation au changement climatique, et l’autre aux aspects économiques de l’atténuation de ce changement.
Lorsqu'ils traitent de questions économiques et sociales, les travaux de ces groupes relèvent surtout des sciences humaines, et non des sciences "dures" (mais pas... "in-humaines" !), qui régissent les mouvements et les échanges de chaleur dans le système climatique.
Il ne faut en rien y voir une supériorité des secondes sur les premières, mais simplement reconnaître la difficulté d'adapter le vivre ensemble des êtres humains aux lois intangibles de la physique.
Les rapports des GT II & III paraissent quelques mois après ceux du GT I. En 2007 comme en 2014, ils ont été beaucoup moins commentés par les médias à destination du grand public.
- Détails
- Écrit par : Raymond Zaharia
- Catégorie parente: Blog
- Catégorie : Climat
Radars de précipitation : étranges rayons de vélo
Pierre Chevallier et Jean Pailleux - août 2023
En examinant régulièrement le signal radar de précipitation fourni par le site météorologique windy.com sur une zone situé à l’ouest de Toulouse, nous nous sommes aperçus qu’assez fréquemment un étrange signal fixe et parfaitement linéaire apparaît, alors que le ciel est clair, sans précipitation ou annonce de précipitation :
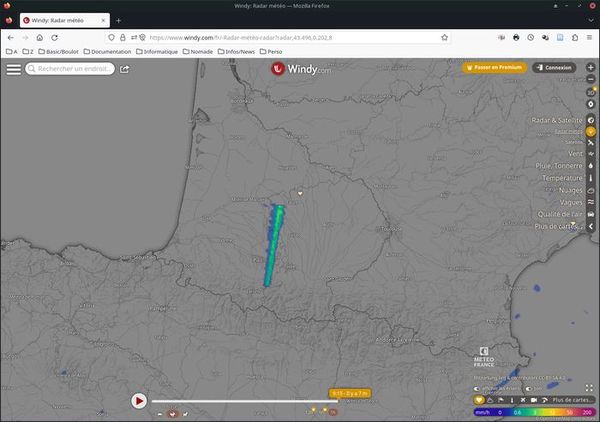
Copie d’écran : windy.com, le 4 avril 2023 à 9h22.
En élargissant l’échelle on s’aperçoit que l’origine de cette anomalie se trouve en Espagne avec l’apparition de signaux semblables à des rayons de vélo centrés sur les radars de Saragosse, Valence et Majorque.
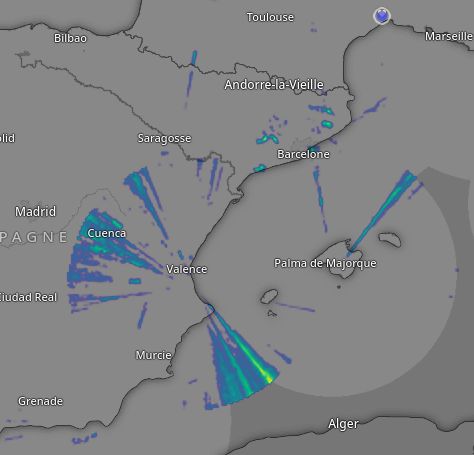
Copie d’écran : windy.com le 18 avril 2023 à 11h51
- Détails
- Écrit par : Pierre Chevallier et Jean Pailleux
- Catégorie parente: Blog
- Catégorie : Météo
Lire la suite : Radars de précipitation : étranges rayons de vélo
Monitoring de l’océan : acquisition de données biogéochimiques par des flotteurs
Résumé en langage courant
Quel impact aura l’évolution en cours du climat sur la chimie et la biologie des océans ?
Sans des observations globales et permanentes, il est difficile d’y répondre. En effet, le seul système global dont on a disposé jusqu’à présent est l’observation de la couleur de l’océan depuis des satellites, qui permet d’estimer la concentration en chlorophylle à la surface, et, à partir de là, la photosynthèse marine. Ceci reste insuffisant lorsqu’on veut estimer les effets du changement climatique sur l’évolution des peuplements marins, sur le transfert de carbone en particules vers le fond, ou sur le contenu en oxygène de l’eau profonde.
Un réseau d’observations en gestation depuis 2007 monte actuellement en puissance et pourrait combler ce manque : Biogeochemical-Argo (BGC-Argo) est une extension du réseau des flotteurs Argo qui effectuent des mesures de température et de salinité entre la surface et 2000 mètres de profondeur. BGC-Argo ajoute à ces flotteurs des capteurs sensibles à des variables biogéochimiques, et la couverture globale de l’océan par au moins 1000 flotteurs est espérée avant 2030.
- Détails
- Écrit par : Yves Dandonneau
- Catégorie parente: Blog
- Catégorie : Océan
Lire la suite : Monitoring de l’océan : acquisition de données biogéochimiques par des flotteurs